Anthropologie et Sciences Humaines
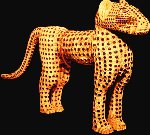
Le freudisme en critique
Tous droits r´┐Żserv´┐Żs ´┐Ż Lierre & Coudrier ´┐Żd. Parution originale, Hommes & Faits, 1998
Illel Kieser Le ´┐Ż travail de m´┐Żmoire ´┐Ż inspire actuellement la r´┐Żvision douloureuse des l´┐Żgendes constitutives des Nations, des id´┐Żologies et des cultures nationales. Tel est le cas pour l'histoire r´┐Żcente de l'Europe. Ainsi, ´┐Ż la faveur d'une comm´┐Żmoration, une histoire r´┐Żaliste de l'abolition de l'esclavage permet-elle aux jeunes g´┐Żn´┐Żrations de d´┐Żcouvrir l'ampleur d'un monstrueux n´┐Żgoce ainsi que les luttes qui retard´┐Żrent sa disparition.
Ainsi, consid´┐Żrer qu'il y eut, durant quatre si´┐Żcles, environ 50 millions de d´┐Żport´┐Żs et pr´┐Żs de 200 millions d'individus massacr´┐Żs peut laisser pantois !´┐Ż
Par fragments, l'histoire de la d´┐Żcolonisation livre peu ´┐Ż peu ses secrets. Le plus souvent, ces revisitations des faits historiques rev´┐Żtent un caract´┐Żre spectaculaire du fait de l'impact des m´┐Żdias qui en reprennent la substance ´┐Ż la faveur d'un proc´┐Żs, d'un film ou d'un ´┐Żv´┐Żnement. On ne peut, en ce domaine, n´┐Żgliger l'´┐Żuvre p´┐Żdagogique des m´┐Żdias qui d´┐Żpouillent l'histoire des pays europ´┐Żens des belles l´┐Żgendes ´┐Żclatantes de courage et d'h´┐Żro´┐Żsme. Enrichissant des pans entiers de l'Histoire, se d´┐Żvoilent maintenant des vertus plus humaines, l'hypocrisie, l'int´┐Żr´┐Żt, le nationalisme primaire... Malheureusement ce mode de transmission demeure souvent sommaire et sans nuance, comme si la ´┐Ż p´┐Żdagogie m´┐Żdiatique ´┐Ż ne devait viser qu'un peuple inculte.Plan
Mutations culturelles
Si ces r´┐Żvisions sont possibles c'est parce que, dans les replis de nos cultures, le cours des id´┐Żes le permet. Tel est le premier effet positif de l'effondrement spectaculaire des id´┐Żologies. Ce ne sera s´┐Żrement pas le dernier !
La critique des id´┐Żes ne suit pas la pente du petit ´┐Żcran. Dans ce domaine ´┐Ż celui de la transmission des id´┐Żes ´┐Ż les m´┐Żdias seraient plut´┐Żt en retard. L'´┐Żuvre de relecture se fait plus silencieusement, au sein d'une ´┐Żlite qui a tendance ´┐Ż taire ses dissensions. On se souvient de la pol´┐Żmique n´┐Że dans les ann´┐Żes 80 de l'implication de Martin Heidegger, ce chantre des penseurs sorbonniens, dans l'´┐Żvolution des id´┐Żes nazies. Qui savait que, d´┐Żs les ann´┐Żes 60, Pol Pot, le tyran sanguinaire du Cambodge, avait soutenu en Sorbonne une th´┐Żse dans laquelle il exposait des id´┐Żes tr´┐Żs pr´┐Żcises sur ce qui allait ´┐Żtre mis en ´┐Żuvre au cours des ann´┐Żes noires suivant son arriv´┐Że au pouvoir ? Durant cette p´┐Żriode qui encensait le communisme, toute critique ´┐Ż son encontre ´┐Żtait v´┐Żcue comme un acte de collusion avec l'ennemi capitaliste. Il n'y eut gu´┐Żre que Hanna Arendt pour m´┐Żler nazisme et communisme au sein d'une m´┐Żme critique sans concession.
Plus r´┐Żcemment, le proc´┐Żs de Maurice Papon permit de revisiter le mythe d'une France glorieuse et r´┐Żsistante. On y pressentit un de Gaulle moins h´┐Żro´┐Żque, pr´┐Żt ´┐Ż passer outre les informations concernant les d´┐Żportations pour assurer la coh´┐Żrence de l'´┐Żtat fran´┐Żais, accordant ainsi l'impunit´┐Ż ´┐Ż certains fonctionnaires. Leur ´┐Żuvre au service de l'´┐Żtat fran´┐Żais fut jug´┐Ż plus importante que leur implication dans les m´┐Żcanismes de d´┐Żportation et de g´┐Żnocide des juifs, des gitans, des homosexuels et des fous... On laissa au peuple la tonte et le lynchage des femmes soup´┐Żonn´┐Żes d'avoir couch´┐Ż avec l'ennemi. Le souvenir de Mai 68 apporte d'autres preuves de cette d´┐Żtermination sans ´┐Żthique d'un chef d'´┐Żtat passant pour un sauveur. On conna´┐Żt en effet sa responsabilit´┐Ż dans la mise en place d'une cellule terroriste - SAC/Barbouzes - charg´┐Że d'´┐Żliminer partout dans le monde les opposants ´┐Ż son r´┐Żgime... Nos mythes constitutifs s'effondrent, pour laisser ´┐Żmerger d'autres repr´┐Żsentations du monde. Nous sommes au moins s´┐Żrs d'une chose, ce n'est pas la raison qui se trouve ´┐Ż l'origine d'un nouveau courant historique mais un r´┐Żseau d'images qui se structure peu ´┐Ż peu en l´┐Żgende. Le mythe doit ´┐Żtre vivant pour traverser l'Histoire, la Raison ne s'occupe que des cadavres. Le mythe est l'´┐Żclaireur de la Raison, il conquiert des champs d'aventure quand la raison s'en tient ´┐Ż l'intendance et ´┐Ż l'´┐Żnum´┐Żration. L'un et l'autre sont pourtant n´┐Żcessairement associ´┐Żs.
Il existe bien d'autres mouvements critiques qui, au sein de l'intelligentsia, mirent directement en cause la mani´┐Żre dont les universitaires et les penseurs occidentaux reprirent sans aucun souci ´┐Żthique des philosophies qui certes, avaient le m´┐Żrite de la coh´┐Żrence mais dont l'origine et l'implication ´┐Żv´┐Żnementielle se r´┐Żv´┐Żl´┐Żrent ´┐Żminemment suspectes, voire catastrophiques pour le genre humain. L'histoire des id´┐Żes est ´┐Żtrange ! On ne sait pas vraiment pourquoi tel courant domine ´┐Ż un moment, ni pourquoi il s'efface. On se perd souvent en conjectures, en vastes d´┐Żbats st´┐Żriles. On sait cependant qu'un courant dominant tend ´┐Ż ´┐Żcarter tout ce qui le mettrait en cause.
Dans certains pays, on assassine ou l'on enferme encore les penseurs s´┐Żditieux ou irr´┐Żv´┐Żrencieux. Sous nos latitudes, il suffit de bien ma´┐Żtriser les m´┐Żcanismes de la m´┐Żdiatisation t´┐Żl´┐Żvisuelle, de contr´┐Żler les circuits ´┐Żditoriaux pour emp´┐Żcher toute insubordination intellectuelle et favoriser la transmission d'id´┐Żes plus complaisantes ou consensuelles.Retour vers le haut de page Les dogmes
Une certaine sensibilit´┐Ż culturelle se transmet lentement aux jeunes g´┐Żn´┐Żrations, ´┐Ż l'´┐Żcole, au coll´┐Żge puis ´┐Ż travers les m´┐Żdias... Cela prend du temps, celui du passage de chaque g´┐Żn´┐Żration des rangs de l'enfance ´┐Ż ceux du pouvoir et de la ma´┐Żtrise d'un m´┐Żtier.
Si les id´┐Żologies disparaissent, y compris les para-religieuses, ce n'est pas pour autant qu'une r´┐Żvolution s'accomplit dans les mentalit´┐Żs. Les dogmes ont la vie dure. Leur agonie dure souvent le temps du fanatisme et des d´┐Żbordements passionnels. Ainsi, dans le domaine des sciences humaines, la double influence du Marxisme et du Freudisme persiste et les antiques l´┐Żgendes tapissent encore l'histoire de ces courants. Ils se trouvent encore de nombreuses chaires d'universit´┐Żs pour propager les id´┐Żes de Marx et de Freud et ce malgr´┐Ż le travail de m´┐Żmoire commenc´┐Ż d´┐Żs 1970.
Finalement, c'est sur le terrain et non dans les universit´┐Żs que la contestation des dogmes de la psychanalyse fut la plus virulente et la plus efficace. Quand, juges, ´┐Żducateurs et parents se mirent ´┐Ż secouer la v´┐Żrit´┐Ż universelle du ´┐Ż fantasme de l'inceste ´┐Ż pour faire face, expliquer et ´┐Żradiquer la maltraitance des enfants et la p´┐Żdophilie. Si les m´┐Żdias rendirent forc´┐Żment compte des nouvelles dispositions des op´┐Żrateurs sociaux, il faut savoir que, en situation, cela correspondait ´┐Ż un long travail de prise de conscience et ´┐Ż de nouvelles mani´┐Żres d'assumer les responsabilit´┐Żs d´┐Żvolues ´┐Ż chaque cat´┐Żgorie professionnelle. Concr´┐Żtement, on prit conscience lentement que la th´┐Żorie freudienne ne rendait plus compte des faits.Retour vers le haut de page Influence du freudisme et mani´┐Żres d'envisager la maltraitance des enfants
Le travail de Sigmund Freud, sur les souvenirs r´┐Żprim´┐Żs et les fantasmes sexuels a sans doute exerc´┐Ż une influence profonde sur la pens´┐Że et sur la soci´┐Żt´┐Ż du XXe si´┐Żcle. D´┐Żs 1890, le fondateur de la psychanalyse est fascin´┐Ż par les questions que pose le comportement hyst´┐Żrique. Beaucoup de ses patients souffrant de n´┐Żvrose ont, croit-il alors, v´┐Żcu une exp´┐Żrience sexuelle traumatisante au cours de leur enfance. En 1895-96, il publie plusieurs textes dont les ´┐Żtudes sur l'hyst´┐Żrie, en collaboration avec Joseph Breuer, dans lesquels est pr´┐Żsent´┐Że sa th´┐Żorie de la s´┐Żduction, dont il estime qu'elle sera ´┐Ż la cl´┐Ż qui ouvre tout ´┐Ż. L'id´┐Że qu'il y expose est que l'hyst´┐Żrie, et plus g´┐Żn´┐Żralement les n´┐Żvroses, ont pour cause le souvenir r´┐Żprim´┐Ż d'un attentat sexuel. Mais, ´┐Ż partir de 1897, Freud r´┐Żvise ses conceptions. Il admet que le r´┐Żle majeur d'une exp´┐Żrience sexuelle r´┐Żellement v´┐Żcue dans l'enfance n'est pas cr´┐Żdible. Or, beaucoup de ses patients mettent en cause un parent incestueux, ou le spectacle rem´┐Żmor´┐Ż de relations sexuelles entre adultes. Freud r´┐Żinterpr´┐Żte alors ces souvenirs comme ´┐Żtant, chez ces patients, l'expression de fantasmes sexuels r´┐Żprim´┐Żs. La th´┐Żorie de la s´┐Żduction traumatique ´┐Żvoluera vers la mise en place au c´┐Żur de la th´┐Żorie freudienne du complexe d'´┐Żdipe, qui appara´┐Żtra vraiment sous ce terme en 1910 comme complexe universel.
Selon cette th´┐Żorie, l'enfant est sexuellement attir´┐Ż par le parent du sexe oppos´┐Ż, et de ce fait ´┐Żprouve pour le parent du m´┐Żme sexe des sentiments de rivalit´┐Ż et d'hostilit´┐Ż. Alors que Freud, dans un premier temps, croit aux r´┐Żcits d'abus sexuels de ses patients, id´┐Że qu'il exprime dans la th´┐Żorie de la s´┐Żduction, dans un second temps, il finit par consid´┐Żrer ces r´┐Żcits comme des fantasmes r´┐Żprim´┐Żs. Ainsi na´┐Żt le principe de " conversion " qui correspond, selon la tradition, ´┐Ż la naissance de la psychanalyse.
Un tel revirement inspira le respect pour une th´┐Żorie devenue coh´┐Żrente et f´┐Żconde gr´┐Żce ´┐Ż la maturation de son concepteur. Coh´┐Żrente car elle rendait compte de l'opinion que l'on avait ´┐Ż l'´┐Żpoque de ces faits ; f´┐Żconde car elle pouvait ainsi avoir acc´┐Żs aux publications et, par cons´┐Żquent traverser un pan d'Histoire. Une concession ´┐Ż la rumeur puritaine pour assurer plus efficacement son pouvoir .... N'est-ce pas ?
Plus tard, sous la pression du terrain, certains universitaires ´┐Ż le plus souvent am´┐Żricains ´┐Ż se mirent ´┐Ż interpr´┐Żter les faits fort diff´┐Żremment.Une th´┐Żorie mal comprise ?
Selon leur point de vue, ce changement d'orientation aurait pour cause la pression que ses pairs exer´┐Żaient sur Freud. Les premiers textes de 1895-1896 sur la s´┐Żduction ont ´┐Żt´┐Ż mal re´┐Żus. On n'acceptait tout simplement pas que les abus sexuels sur des enfants aient pu se produire aussi couramment. Ce d´┐Żsaveu de la profession a-t-il ´┐Żt´┐Ż difficile ´┐Ż accepter pour quelqu'un qui pla´┐Żait sa propre th´┐Żorie au-dessus de toutes celles qui l'avaient pr´┐Żc´┐Żd´┐Że ? Se pourrait-il qu'il n'ait pas eu le courage d'affronter ces critiques ? Une chose est s´┐Żre, sans le vouloir, Freud a certainement donn´┐Ż du grain ´┐Ż moudre ´┐Ż ceux, qui aujourd'hui red´┐Żcouvrent sa m´┐Żthode d'origine pour cr´┐Żer de faux souvenirs d'abus sexuels. (Vraies victimes et faux souvenirs des abus sexuels, in Le Monde du 10/10/97, p. 27. Voir ´┐Żgalement in Science & Vie Junior, N´┐Ż32, Hors s´┐Żrie, Le cerveau et la m´┐Żmoire, notamment l'article de Claire Dupr´┐Ż : Les faux souvenirs.
Commentant dans ses premi´┐Żres ´┐Żtudes de cas le processus par lequel les patients se souviennent des violences v´┐Żcues dans l'enfance, Freud ´┐Żcrit : ´┐Ż Avant de venir en analyse les patients ignoraient tout de ces sc´┐Żnes (...) ils s'indignaient r´┐Żguli´┐Żrement si on les avertissait de leur apparition. ´┐Ż Il dit ensuite n'avoir r´┐Żussi ´┐Ż retrouver les souvenirs d'abus sexuels anciens que ´┐Ż sous la pression la plus ´┐Żnergique du processus analytique, et en luttant contre une ´┐Żnorme r´┐Żsistance ´┐Ż.
Toujours ´┐Ż la m´┐Żme ´┐Żpoque : une fois l'hyst´┐Żrie diagnostiqu´┐Że et la cause identifi´┐Że comme un souvenir sexuel r´┐Żprim´┐Ż, le psychiatre doit ´┐Ż exiger vigoureusement du sujet confirmation de ses soup´┐Żons. Il ne faut pas se laisser ´┐Żgarer par les premiers d´┐Żmentis. Nous en tenant r´┐Żsolument ´┐Ż nos conclusions, nous aurons raison de toutes les r´┐Żsistances ´┐Ż.
Il revint donc sur toutes ces affirmations pour contester l'´┐Żventualit´┐Ż d'une r´┐Żalit´┐Ż attach´┐Że ´┐Ż ces faits et b´┐Żtir sa th´┐Żorie des fantasmes, transformant d´┐Żfinitivement un doute sur le pass´┐Ż en virtualit´┐Ż fantasmatique.
Souvenons-nous que le viol des femmes fut longtemps consid´┐Żr´┐Ż plus ou moins clairement comme la r´┐Żsultante d'un d´┐Żsir inconscient de la victime... Et il fallait ´┐Ż ces femmes toute la force de leur douleur et de leur r´┐Żvolte pour faire valoir la r´┐Żalit´┐Ż du crime dont elles avaient ´┐Żt´┐Ż victimes.
Ainsi, selon ses d´┐Żtracteurs, le freudisme serait en cause dans le retard pris ´┐Ż valider la r´┐Żalit´┐Ż des faits de violences exerc´┐Żs sur les enfants. La conviction seconde selon laquelle certaines de ces accusations seraient l'expression de fantasmes pourrait avoir encourag´┐Ż de nombreux sp´┐Żcialistes, jusque dans les ann´┐Żes 70, ´┐Ż nier la r´┐Żalit´┐Ż des r´┐Żcits accusateurs en donnant aux souvenirs ´┐Żventuels une cause toute autre, bien ficel´┐Że. Il se trouve encore des sp´┐Żcialistes pour consid´┐Żrer qu'aider un enfant ´┐Ż d´┐Żnoncer les violences qu'il subit porte atteinte ´┐Ż la structuration de sa personnalit´┐Ż.Retour vers le haut de page Critique et changement de dogme
Proc´┐Żder de cette mani´┐Żre est assez sommaire ! Que l'on mette en cause la th´┐Żorie freudienne, soit ! Il importe cependant de s'interroger sur les m´┐Żcanismes institutionnels qui ont permis d'occulter si longtemps des faits av´┐Żr´┐Żs. Comment les praticiens ont-ils pu se laisser abuser de cette fa´┐Żon : occulter la sensibilit´┐Ż de leur jeunes interlocuteurs et s'en tenir au dogme freudien ?
Une telle question est bien plus importante car la r´┐Żponse permettrait ´┐Żgalement de comprendre comment une th´┐Żorie op´┐Żrante durant un temps peut se transformer en une croyance st´┐Żrile et dangereuse, soutenue par des personnes auxquelles on accorde cr´┐Żdit de par leur fonction de savants et d'experts, auxquelles l'on se confie avec d'autant moins de r´┐Żserve que leur r´┐Żle est d'´┐Żtre sensibles ´┐Ż nos v´┐Żrit´┐Żs intimes.
Comment peut-on se laisser abuser par une pseudo-coh´┐Żrence scientifique et perdre tout sens humain alors m´┐Żme que l'on est sens´┐Ż demeurer ´┐Ż l'´┐Żcoute du sujet et charg´┐Ż d'´┐Żlucider avec lui le fil de son histoire ?
La question de la responsabilit´┐Ż des chercheurs et inventeurs dans les sciences humaines, depuis 1920, reste pos´┐Że. Il n'est pas possible d'´┐Żluder le probl´┐Żme de la responsabilit´┐Ż personnelle dans une acceptation sans critique, sous pr´┐Żtexte que Freud aurait impos´┐Ż quoique ce soit.
On sait depuis les origines de la pens´┐Że scientifique qu'une v´┐Żrit´┐Ż demeure locale et temporelle. Elle ne peut ´┐Żtre universelle m´┐Żme si sa coh´┐Żrence para´┐Żt rendre compte absolument des faits et ´┐Żv´┐Żnements qu'on lui soumet. Il manque ´┐Ż nos sciences humaines un volet critique qui permettrait un passage moins heurt´┐Ż d'une v´┐Żrit´┐Ż du moment ´┐Ż une autre.
Il leur manque ´┐Żgalement la possibilit´┐Ż de rendre compte des travaux et recherche dans une enceinte int´┐Żgre, d´┐Żpouill´┐Że des influences des ´┐Żcoles et cartels divers qui g´┐Żlent tout forme de critique par des anath´┐Żmes. Se constituer en discipline majeure en quelque sorte !Illel Kieser, Mauvezin le 02/02/2001
Plan du site ´┐Ż Vers le haut de page ´┐Ż En savoir plus sur l'auteur
Envoyez vos commentaires et vos questions au r´┐Żgisseur du site. Copyright ´┐Ż ´┐Ż 1997 Lierre & Coudrier ´┐Żditeur