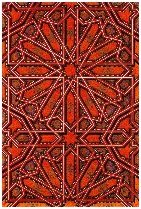|
| ||
|
Analyse de l'entr�e sur le terrain
| ||
|
| ||
|
L'ethnographie, tout comme la psychosociologie, est favorable � une analyse de l'entr�e sur le terrain..  Peter Woods parle de trois phases. Tout d'abord, l'�cole se pr�sente dans ses � habits du dimanche �, c'est-�-dire dans son meilleur aspect, comme pour une � porte ouverte � ou une inspection. Puis les acteurs de l'�tablissement se laissent approcher, observer, interviewer, questionner; mais ceux-ci gardent leurs distances. Ils sont encore m�fiants et surveillent toujours le chercheur du � coin de l'�il �;. Dans une troisi�me phase, les barri�res tombent et une confiance s'�tablit. Les protagonistes parlent sans retenue. C'est le moment id�al pour le chercheur de collecter les secrets, les confidences. C'est une phase d�cisive. P. Woods dit que l'on atteint � les centres vitaux de l'organisation �, c'est-�-dire l'intimit� de l'�cole. Le chercheur n'atteint pas les stades au m�me moment. Avec telle personne, il se trouvera dans le premier stade, et avec telle autre, il entrera dans le troisi�me niveau. Parfois m�me, il sera impossible de cr�er une v�ritable relation de confiance avec un protagoniste.  Il est possible d'entrer dans une �cole de plusieurs fa�ons. Par la voie administrative, en rencontrant le chef d'�tablissement par exemple, ou par le biais d'une relation que l'on a d�j� avec un membre de l'�tablissement, un professeur par exemple. Cette voie d'entr�e est tr�s importante, non-n�gligeable et � analyser absolument. En effet, si le chercheur est pr�sent� � la communaut� �ducative par le directeur, cela peut fermer des portes d'acc�s � certaines classes, o� les enseignants verront en le chercheur un oeil complice de la direction. De m�me, s'il est introduit par un enseignant, monsieur X, il portera durant quelques temps un grand panneau dans le dos disant : � je suis l'ami de monsieur X �. Les sentiments qui sont habituellement port�s vers monsieur X seront report�s vers le chercheur (rivalit�s, antipathie, complicit�,...). Certaines difficult�s � rentrer en contact avec des acteurs peuvent avoir comme origine ce qui a �t� dit pr�c�demment. Des astuces peuvent �tre mises en place afin d'�viter les oppositions actives � la recherche de quelques personnes, en les consid�rant comme � co-chercheur �, et non plus comme objet de recherche.  L'analyse de la n�gociation de l'acc�s au terrain passe �galement par un questionnement sur les attentes du membre vis-�-vis du chercheur. Parfois, il faut ren�gocier les conditions de la recherche avec un enseignant. Celui-ci peut vouloir transformer le chercheur en aide p�dagogique ou en potiche au fond de la classe (tout d�pend du niveau de participation souhait� par le chercheur). Certains professeurs peuvent s'investir �norm�ment dans la recherche et appr�cier la pr�sence du chercheur. Cette sur-motivation doit �tre analys�e afin de bien comprendre les raisons qui poussent l'enseignant � agir de cette sorte. Celles-ci peuvent �tre multiples. Notons l'exemple d'une �tudiante de P. Boumard qui s'est aper�ue, au bout de quelques temps, que la bonne relation qu'elle entretenait avec un professeur n'�tait qu'une ruse et que ce dernier �tait davantage int�ress� par l'�tudiante que par la recherche.  La fa�on de se pr�senter est tr�s importante. Qui sommes-nous? �tudiant, �tudiant-chercheur, chercheur ? Que venons-nous observer ? une classe, l'�cole, les enseignants ? Comment faut-il appara�tre physiquement ? � ce propos, Georges Lapassade relate dans Pratiques de formation n� 20, pages 119-120, un extrait du livre de Delamont o� elle � d�crit ses changements de tenue dans l'�cole o� elle menait une recherche. Elle se pr�senta au directeur avec des habits classiques, des gants. Avec les �l�ves, elle s'effor�a au contraire de montrer qu'elle suivait la mode "jeune" �.Toutes ces questions doivent se poser avant d'entrer sur le terrain et analyser par la suite.   L'acc�s au terrain doit �tre analys� avec minutie. Le chercheur doit s'interroger sur la fa�on dont il va se pr�senter, sur les cons�quences qui vont �tre produites suite � son introduction dans l'�tablissement par un membre, et sur les relations qu'il aura tout au long de sa recherche. Entrer sur le terrain ne suffit pas avoir l'autorisation administrative de le faire, il faut quotidiennement construire des relations de confiance avec les membres de l'institution, afin � (...) de sortir d'une description superficielle souvent productrice d'interpr�tation sommaires ou erron�es (...) �.(P. Boumard, Pratiques de formation, n� 20, page17).
Pierre-Yves Allain, juin 1997.
| ||
Envoyez vos commentaires et vos questions au r�gisseur du site. Copyright � � 1997 Lierre & Coudrier �diteur |