| |||||
Quoi sur le site ?... je crois que le fait de ressentir les valeurs esth´┐Żtiques de la nature
est un fait pal´┐Żontologique et peut-´┐Żtre ant´┐Żrieur aux primates.
De l'actualit´┐Ż telle qu'elle se donne ´┐Ż voir ´┐Ż travers les m´┐Żdias jusqu'´┐Ż la synth´┐Żse des faits et leur
int´┐Żgration au sein d'une vision globale qui permette, sinon de pr´┐Żvoir au moins d'expliquer.
Ces intentions traduisent l'architecture logique du site.
Nous partons des m´┐Żdias, des faits bruts, vus de loin par nous, puis nous donnons la parole ´┐Ż ceux qui
vivent les faits, sur place. C'est ce que nous nommons "t´┐Żmoignage" ou "carnet de route".
Si nous voulons vraiment comprendre ce qui se passe, conscient que nous sommes des contradictions
souvent tragiques qui traversent nos soci´┐Żt´┐Żs, il importe que nous revenions aux sources de notre
histoire et de nos philosophies...
Nos intentions
Pour une anthropologie des faits de soci´┐Żt´┐Ż ! 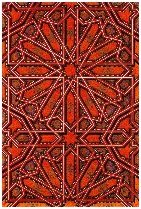
Participer ´┐Ż une d´┐Żfinition claire des objets de l´┐ŻAnthropologie, tel serait l'objectif de cette revue en ligne. L'Anthropologie n'a point pour seul objet les soci´┐Żt´┐Żs diff´┐Żrentes des n´┐Żtres. Les plus lointains voyages sont d´┐Żsormais int´┐Żrieurs. Des collines des Balkans aux sites aust´┐Żres du Kurdistan, c'est ´┐Ż lui-m´┐Żme que se trouve sans cesse renvoy´┐Ż l'anthropologue par le regard des autres. De sa propre repr´┐Żsentation du monde ´┐Ż celles des peuples dont il s´┐Żest donn´┐Ż pour mission de rapporter coutumes et faits, il y a parfois un ab´┐Żme que lui seul peut combler. ´┐Ż L´┐ŻAnthropologie est donc, en retour, auto-analyse de l'observateur et retour critique sur sa soci´┐Żt´┐Ż d'origine. Deux axes simultan´┐Żs orientent la d´┐Żmarche anthropologique. D'une part, ´┐Żtudier l'Homme dans son int´┐Żgralit´┐Ż, dans les architectures de son corps (anthropologie biologique, qui ordonne les variations des caract´┐Żres biologiques de l'homme dans l'espace et dans le temps) comme dans celles qu'il a am´┐Żnag´┐Żes pour vivre en soci´┐Żt´┐Ż, en exploitant les potentialit´┐Żs de son intellect et de son affectivit´┐Ż (anthropologie sociale et culturelle). Les lents processus de d'hominisation ont vu s'´┐Żlaborer les premi´┐Żres exp´┐Żriences de vie sociale dans lesquelles nos anc´┐Żtres se sont donn´┐Ż des mod´┐Żles de comportement et les moyens d'inciter ´┐Ż leur respect. Sauf dans le reflet trouble et lointain des soci´┐Żt´┐Żs animales, ou ´┐Ż travers l'´┐Żtude des vestiges exhum´┐Żs par les pr´┐Żhistoriens, nous devons nous r´┐Żsigner ´┐Ż ne presque rien conna´┐Żtre de ces temps o´┐Ż l'humanit´┐Ż s'inventa en soci´┐Żt´┐Ż. L'Anthropologie juridique, quant ´┐Ż elle, trouve sa source factuelle dans les mutations biologiques qui ont engendr´┐Ż l'esp´┐Żce humaine, elle ne peut souvent saisir que des manifestations achev´┐Żes d'ensembles culturels dont la gen´┐Żse, faute de documents exploitables, lui demeure cel´┐Że. Elle se donne pour objet d'y ´┐Żtudier les discours, pratiques et repr´┐Żsentations que chaque soci´┐Żt´┐Ż consid´┐Żre comme essentiels ´┐Ż son fonctionnement et ´┐Ż sa reproduction. Traditionnellement, l'histoire se penchait sur les soci´┐Żt´┐Żs du pass´┐Ż ; la sociologie et l'ethnologie sur celles du pr´┐Żsent, divis´┐Żes en soci´┐Żt´┐Żs de la modernit´┐Ż et de la tradition. Ces partages n'ont pas de nos jours disparu, mais ils perdent sans cesse de leur pertinence. L'esp´┐Żce humaine est marqu´┐Że par la variation culturelle, car pour se forger son identit´┐Ż, l'homme produit de la diff´┐Żrence. On n'existe que par rapport ´┐Ż d'autres, proc´┐Żdant du semblable ´┐Ż l'´┐Żtranger. Face ´┐Ż la prolif´┐Żration des syst´┐Żme sociaux et juridiques, l'anthropologie d´┐Żveloppe un effort classificatoire, pr´┐Żalable de la d´┐Żmarche comparative. Sur la nature et la finalit´┐Ż de la syst´┐Żmatisation comparative, les courants de pens´┐Że sont eux-m´┐Żmes divers. Les culturalistes mettent l'accent sur la sp´┐Żcificit´┐Ż du syst´┐Żme de valeurs propre ´┐Ż un groupe, les structuralistes s'efforcent de d´┐Żterminer un ordre sous-jacent ´┐Ż la variabilit´┐Ż culturelle[1]. Que l'on doive trouver l'unit´┐Ż ou la pluralit´┐Ż derri´┐Żre la variabilit´┐Ż, l'anthropologie sociale poss´┐Żde une vocation de globalisation, m´┐Żme si le programme reste ´┐Ż l'heure actuelle loin d'´┐Żtre rempli : fondamentalement, elle n'est exclusive d'aucune soci´┐Żt´┐Ż, pr´┐Żsente ou pass´┐Że, industrialis´┐Że ou ´┐Ż´┐Żexotique´┐Ż´┐Ż. Cependant, pour des raisons historiques, essentiellement dues aux colonisations et au grand partage op´┐Żr´┐Ż par A. Comte entre sociologie et ethnologie, l'anthropologie a d'abord pris pour objet d'´┐Żtude les soci´┐Żt´┐Żs diff´┐Żrentes de celles de l'Occident. Les enqu´┐Żtes ethnographiques et les constructions th´┐Żoriques op´┐Żr´┐Żes sur cette base portent essentiellement sur les soci´┐Żt´┐Żs dites ´┐Ż´┐Żtraditionnelles´┐Ż´┐Ż. Ce n'est que r´┐Żcemment que les soci´┐Żt´┐Żs occidentales font aussi l'objet d'´┐Żtudes anthropologiques (Anthropologie urbaine, ethnopsychiatrie, etc.).´┐Ż ´┐Ż La partie la plus importante de ce site sera consacr´┐Ż ´┐Ż l´┐Ż´┐Żtude des soci´┐Żt´┐Żs modernes. Mais nous entendons aussi comme moderne, par exemple, la mani´┐Żre dont les peuples Akhas de Tha´┐Żlande n´┐Żgocient la survie de leur culture.[2] Il est en effet, totalement exclu de consid´┐Żrer qu´┐Żil s´┐Żagit l´┐Ż du sauvetage d´┐Żune soci´┐Żt´┐Ż ancienne au pr´┐Żtexte qu´┐Żelle appartient au patrimoine de l´┐Żhumanit´┐Ż. Ce combat de la ´┐Ż´┐Żpr´┐Żservation des peuples et esp´┐Żces en p´┐Żril´┐Ż´┐Ż n´┐Żest pas l´┐Żobjet de l´┐ŻAnthropologie. Par contre la dynamique d´┐Żinteractivit´┐Ż entre une soci´┐Żt´┐Ż et une autre, entre le pass´┐Ż et un futur ind´┐Żfini, est du ressort de l´┐ŻAnthropologie. Elle met en jeu des clivages qu´┐Żil est important de conna´┐Żtre et d´┐Ż´┐Żtudier car, sur la Plan´┐Żte bleue, ce qui r´┐Żussit pour les Sorabes de Lusace[3] peut ´┐Żventuellement r´┐Żussir pour d´┐Żautres peuples. ´┐ŻL´┐ŻAnthropologue est donc autant m´┐Żdiateur, collecteur d´┐Żinformations que p´┐Żdagogue. Telle sera aussi la vocation de ce site, alliant le recueil de t´┐Żmoignages ´┐Ż des
´┐Żcrits plus fouill´┐Żs de m´┐Żthodologie ou de th´┐Żorisation. [1] ´┐Ż Il y a trente ans, C. L´┐Żvi-Strauss, fixait le programme propre ´┐Ż cette deuxi´┐Żme orientation : ´┐Ż si, comme nous le croyons, l'activit´┐Ż inconsciente de l'esprit consiste ´┐Ż imposer des formes ´┐Ż un contenu, et si ces formes sont fondamentalement les m´┐Żmes pour tous les esprits, anciens et modernes, primitifs et civilis´┐Żs (...) il faut et il suffit d'atteindre la structure inconsciente, sous-jacente ´┐Ż chaque institution ou ´┐Ż chaque coutume, pour obtenir un principe d'interpr´┐Żtation valide pour d'autres institutions et d'autres coutumes, ´┐Ż condition, naturellement, de pousser assez loin l'analyse. ´┐Ż C. L´┐Żvi-Strauss, Anthropologie structurale, Paris, Plon, 1974, p.28 (o´┐Ż est repris un texte publi´┐Ż pour la premi´┐Żre fois en 1949). [2] ´┐Ż Ils effectuent actuellement un recensement de leurs f´┐Żtes annuelles et recueillent autant d´┐Żinformations que possible ´┐Ż leur sujet. Pour ce faire, ils n´┐Żh´┐Żsitent pas ´┐Ż utiliser les moyens de la technologie moderne´┐Ż: ´┐Żvid´┐Żos, sites Internet., etc. [3] ´┐Ż ´┐Żcras´┐Żs par un environnement paternaliste, les Sourabes ont pris l´┐Żinitiative de se commuer en translateurs des cultures germaniques et slaves, propulsant ainsi leur minorit´┐Ż en voie d´┐Żacculturation en m´┐Żdia incontournable. Arguments... dans mon ´┐Żtat d'esprit actuel, mon espoir
´┐Ż qui n'a absolument rien de social ni d'humanitaire ´┐Ż c'est l'id´┐Że que,
apr´┐Żs tout, si j'arrive encore ´┐Ż trouver de la po´┐Żsie quelque
part, c'est que tout n'est pas absurde. 
Un monde en crise ? En mutation plut´┐Żt. Des fronti´┐Żres s'ouvrent, des civilisations s'´┐Żteignent, des r´┐Żgimes s'´┐Żcroulent pendant que des cultures m´┐Żconnues passent ´┐Ż l'avant-sc´┐Żne, que de nouvelles techniques envahissent notre quotidien. L'Occident est plac´┐Ż face ´┐Ż la n´┐Żcessit´┐Ż de remettre en question quelques-unes de ses certitudes ´┐Ż et le renoncement ´┐Ż d'anciennes formes de puissance peut appara´┐Żtre, certes, comme une petite mort. Nos soci´┐Żt´┐Żs sont d´┐Żsormais amen´┐Żes ´┐Ż prendre en compte d'autres cultures, d'autres autorit´┐Żs, d'autres modes de pens´┐Że. Comment l'Homme, l'´┐Żtre humain en g´┐Żn´┐Żral, r´┐Żagit-il ´┐Ż ces transformations ? Quelles perspectives s'offrent ´┐Ż lui ´┐Ż l'heure d'une culture plan´┐Żtaire ? Quel usage faisons-nous du confort mat´┐Żriel que les technologies nous offrent ? Qu'avons-nous fait de vraiment s´┐Żrieux pour saisir la finalit´┐Ż de tous ces changements et les relier ´┐Ż d'autres moments de l'Histoire ? A quel sort avons-nous livr´┐Ż de mani´┐Żre irresponsable d'immenses pays que nos arm´┐Żes jadis avaient conquis ? Que reste-t-il des grands id´┐Żaux de l'humanit´┐Ż ? Devant tant de questions aux r´┐Żponses oppressantes, comment ne pas c´┐Żder au pi´┐Żge des passions affol´┐Żes, ´┐Ż la m´┐Żlancolie environnante, ´┐Ż la frilosit´┐Ż ambiante voire ´┐Ż la panique ? Au c´┐Żur des villes, de toutes les villes, l'imaginaire et la po´┐Żsie, eux, sont encore pr´┐Żsents, fruits d'un futur ´┐Ż cueillir... |
|||||
|
´┐Ż | ´┐Ż | |||
| |||||
