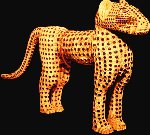T´┐Żmoins de nos m´┐Żurs
Alimentation, culture(s)
et religion(s)
Tous droits r´┐Żserv´┐Żs ´┐Ż Lierre & Coudrier ´┐Żd. Parution originale, Hommes & Faits, 2001
Awad Fouatih
Chaque religion donne une interpr´┐Żtation de la symbolique et du statut de l´┐Żalimentaire, lecture dict´┐Że par le Divin qui indique ´┐Ż l´┐ŻHumain son comportement vis ´┐Ż vis de la nourriture terrestre. Les aliments font partie int´┐Żgrante de notre histoire, de notre vie sinon de notre destin. La th´┐Żologie, discours du religieux qui interpr´┐Żte ce que le divin dans sa langue indique et les Textes liturgiques sont, l´┐Ż, l´┐Żexpression du divin dans le langage de l´┐ŻHumain. Chacun de nous a une fa´┐Żon singuli´┐Żre de se comporter vis ´┐Ż vis de l´┐Żaliment, disciple ou non de telle ou telle religion (syst´┐Żme de r´┐Żf´┐Żrence culturelle codifiant nos rapports aux forces de la Transcendance).
L´┐ŻHomme, depuis son av´┐Żnement sur la Terre, a pratiquement s´┐Żlectionn´┐Ż l´┐Żaliment qui lui a ´┐Żt´┐Ż utile pour sa survie. Il a mis ´┐Żgalement du temps ´┐Ż adapter certains aliments et ´┐Ż rendre domestique ce qui ´┐Żtait naturel. Plus tard, en fonction de sa culture et /ou de sa tradition, il a l´┐Żgif´┐Żr´┐Ż sur les cat´┐Żgories, sur l´┐Żaliment n´┐Żcessaire, agr´┐Żable, utile voire mauvais. En ´┐Żtablissant des r´┐Żgles strictes de codification sur la fa´┐Żon de se nourrir, de manger, de cuire, il a oblig´┐Ż des g´┐Żn´┐Żrations enti´┐Żres ´┐Ż int´┐Żrioriser un certain go´┐Żt et ´┐Ż avoir des habitudes alimentaires pr´┐Ż´┐Żtablies.
Ainsi, d´┐Żun continent ´┐Ż l´┐Żautre, alors qu´┐Żaujourd´┐Żhui il est possible de trouver les m´┐Żmes aliments partout, nous constatons qu´┐Żil y a des mani´┐Żres diff´┐Żrentes de manger, de cuire et de pr´┐Żparer ces m´┐Żmes aliments.
Dans l´┐Żinconscient collectif existe ´┐Ż´┐Ż et l´┐Ż un conditionnement et un apprentissage propres ´┐Ż nos cultures, ´┐Ż nos religions qui nous poussent ´┐Ż trier entre le d´┐Żsirable┬á: le connu et l´┐Żind´┐Żsirable┬á: l´┐Żinconnu.
L´┐Żaliment reste le vecteur de notre culture (de notre religion) car il est porteur de sens. Si je m´┐Żinterdis de manger tel ou tel aliment, c´┐Żest ma ´┐Ż┬áconscience┬á´┐Ż int´┐Żrieure qui me dicte qu´┐Żil y a un tabou (m´┐Żme si parfois j´┐Żignore le pourquoi de cet interdit et je vais essayer de construire un argumentaire logique (souvent le tabou est d´┐Żordre religieux).
La notion de licite et d´┐Żillicite, de sacr´┐Ż et de profane est une dualit´┐Ż qui s´┐Żapparente ´┐Ż la notion universelle du bien et du mal. La diff´┐Żrence se fait alors entre l´┐Żaliment polluant le corps et l´┐Żaliment alli´┐Ż du corps. Manger un aliment d´┐Żtermin´┐Ż est toujours un choix, une activit´┐Ż de l´┐Żesprit qui classe, dicte, choisit en fonction des crit´┐Żres culturels, ´┐Żconomiques et religieux. L´┐Żaliment peut ´┐Żtre aussi, dans certaines traditions, un aliment sacr´┐Ż, c´┐Żest-´┐Ż-dire r´┐Żserv´┐Ż aux Dieux, propre ´┐Ż la consommation par les Dieux, aliment offrande ou de c´┐Żr´┐Żmonie.
Les f´┐Żtes sont des moments sanctuaires o´┐Ż certaines cat´┐Żgories d´┐Żaliments sont consomm´┐Żs, en fonction de l´┐ŻHistoire, de la M´┐Żmoire, de la Tradition┬á; ainsi notre histoire peut-elle s´┐Żapparenter ´┐Ż l´┐ŻHistoire de nos aliments f´┐Żtiches.
Les hommes se nourrissent comme la soci´┐Żt´┐Ż leur a appris ´┐Ż se nourrir┬á; cette ´┐Żvidence para´┐Żt pour certains comme non fond´┐Że. On aime souvent les aliments que notre m´┐Żre nous a appris ´┐Ż consommer. Ainsi nos go´┐Żts et nos d´┐Żgo´┐Żts, nos aversions alimentaires ne sont que le r´┐Żsultat de notre ´┐Żducation, de notre culture, de notre religion.
Le go´┐Żt et les aversions alimentaires se lovent en nous entre le faix de l´┐Żh´┐Żr´┐Żdit´┐Ż et les contraintes de la socialisation. Tout syst´┐Żme alimentaire fonctionne comme un syst´┐Żme de contr´┐Żle, il est un langage de la diff´┐Żrenciation et de la distanciation. Le r´┐Żgime alimentaire indique une appartenance, un id´┐Żal. Il ne faut pas oublier que dans l´┐ŻAncien testament (La Gen´┐Żse - Gen.l,29-30). Il est rappel´┐Ż que le ´┐Ż┬áParadis est v´┐Żg´┐Żtarien┬á´┐Ż et ce n´┐Żest qu´┐Żapr´┐Żs le d´┐Żluge que Dieu permit ´┐Ż l´┐Żhomme de manger diff´┐Żremment. Il est ´┐Żcrit ´┐Ż┬áTout ce qui remue et vit te servira de nourriture┬á´┐Ż.
L´┐Żalimentation, facteur constitutif de l´┐Żidentit´┐Ż culturelle
´┐Ż┬áJe suis ce que je mange, ce que je mange me transforme┬á; le manger transmet certaines caract´┐Żristiques aux mangeurs. En cons´┐Żquent, si je ne sais plus ce que je mange, je ne sais plus qui je suis┬á´┐Ż. Claude Fischeler.
On mange pour vivre ou l´┐Żon vit pour manger, telle est la question que l´┐Żon se pose souvent, face ´┐Ż ce dilemme, la r´┐Żponse est ´┐Ż la fois simple et complexe. Pour vivre il faut se nourrir, nous ne pouvons nous passer de la nourriture. Notre r´┐Żgime alimentaire et la fa´┐Żon de nous nourrir ont ´┐Żvolu´┐Ż au m´┐Żme rythme que nous. Notre histoire, c´┐Żest l´┐Żhistoire de notre alimentation. Notre rapport ´┐Ż l´┐Żalimentation est compliqu´┐Ż et chacun le r´┐Żgle ´┐Ż sa fa´┐Żon, tel l´┐Żanachor´┐Żte ´┐Ż qui il suffit de peu de nourriture pour survivre, l´┐Żessentiel, le fondamental, ´┐Ż sa survie┬á; par contre si l´┐Żon abuse trop de la nourriture comme le boulimique, elle devient dangereuse et peut nous entra´┐Żner vers la mort. Il nous faut donc respecter une certaine mesure, sachant que l´┐Żaliment est ´┐Ż la fois poison et m´┐Żdicament.
L´┐Żalimentation se trouve au centre de notre univers mental et social, elle nous accompagne de notre naissance ´┐Ż notre mort ´┐Ż pour certaines civilisations au-del´┐Ż de la mort par les offrandes effectu´┐Żes quotidiennement sur l´┐Żautel ´┐Żrig´┐Ż ´┐Ż la m´┐Żmoire des anc´┐Żtres -.
L´┐Żapprentissage de nos go´┐Żts et sensations se fait tr´┐Żs t´┐Żt, d´┐Żs notre premi´┐Żre t´┐Żt´┐Że┬á; Les aliments aim´┐Żs sont ceux qui ont le go´┐Żt et la saveur du lait maternel ´┐Ż┬áaromatis´┐Ż┬á´┐Ż. De ce fait notre cerveau capte et fabrique d´┐Żs ce premier moment de notre vie des cat´┐Żgories, en s´┐Żadaptant ou en rejetant par s´┐Żlection certains go´┐Żts. Ainsi pouvons-nous dire que le choix de notre alimentation ne se fait jamais de fa´┐Żon hasardeuse. Ce choix correspond toujours ´┐Ż des cat´┐Żgories pr´┐Żcises qui ont ´┐Ż voir avec notre enfance, notre adolescence, notre milieu social et culturel, en fin de compte avec notre histoire.
Le hasard a peu de place dans nos choix alimentaires. Dire que l´┐Żon aime plus ceci que cela ne d´┐Żnote pas d´┐Żun simple d´┐Żsir individuel, ce d´┐Żsir est conditionn´┐Ż par ce que l´┐Żon a d´┐Żj´┐Ż mang´┐Ż ou aim´┐Ż, m´┐Żme si on a oubli´┐Ż ´┐Ż┬áquand et o´┐Ż┬á?┬á´┐Ż.
L´┐Żalimentation, un fait culturel donc social, induit positivement ou n´┐Żgativement dans notre esprit, et conditionne nos comportements alimentaires. Notre singularit´┐Ż est aussi d´┐Żordre alimentaire.
A cela, il faut ajouter les repr´┐Żsentations symboliques et mythologiques qui viennent illustrer notre perception imaginaire de l´┐Żalimentation┬á; l´┐Żexemple du lait peut tr´┐Żs bien s´┐Żillustrer par le lait de la louve nourrici´┐Żre de Remus et Romulus, comme aliment (avec d´┐Żautres) de pr´┐Żdilection au Paradis. Le lait cr´┐Że des liens de parent´┐Ż indissociables et fait de ceux qui ont ´┐Żt´┐Ż nourris d´┐Żun m´┐Żme sein des ´┐Ż┬áfr´┐Żres et s´┐Żurs de lait┬á´┐Ż┬á: c´┐Żest-´┐Ż-dire qu´┐Żune tierce personne qui donne le sein ´┐Ż d´┐Żautres enfants que les siens fait d´┐Żeux des parents, fr´┐Żres et s´┐Żurs de lait de ses propres enfants. Ce qui les emp´┐Żchera plus tard de se marier entre eux.
Nous voyons que manger engage l´┐Żindividu. Manger est un rite social et culturel qui assure une certaine continuit´┐Ż et une diversit´┐Ż dans les contacts familiaux et sociaux. Manger ensemble correspond ´┐Ż des moments de partage et de plaisir entre famille et amis et participe ´┐Ż l´┐Żunification et ´┐Ż la coh´┐Żsion des groupes, c´┐Żest-´┐Ż-dire ´┐Ż la sociabilit´┐Ż et au maintien du lien social.
Chaque soci´┐Żt´┐Ż a son mode de partage de la nourriture. Celle-ci est faite pour ´┐Żtre partag´┐Że, ne pas le faire est d´┐Żtruire son essence pour soi et pour les autres. Dans l´┐ŻHindouisme, on met en garde ´┐Ż┬ácelui qui mange sans savoir, tue la nourriture, et mang´┐Że, elle le tue┬á´┐Ż. Il faut ´┐Żtre conscient de ce que l´┐Żon mange, manger n´┐Żest pas un acte anodin mais un acte social qui fonde le groupe et le d´┐Żtermine dans le v´┐Żcu de sa communaut´┐Ż de partage. Brillat Savarin (Philosophie du go´┐Żt) nous donne la cl´┐Ż de cette ´┐Żnigme en nous disant┬á: ´┐Ż┬áDis ce que tu manges, je te dirai qui tu es┬á´┐Ż.
L´┐Żhomme moderne mange finalement tout mais ne dig´┐Żre rien, car le plaisir culinaire suppose la connaissance de sa propre cuisine ou du moins de ses rudiments. Ce qui distingue l´┐Żhomme du ruminant par exemple, c´┐Żest la conscience qu´┐Żil a de ce qu´┐Żil mange et le plaisir qu´┐Żil en tire. Chaque civilisation reconstruit un paysage coh´┐Żrent sur des bases alimentaires, le vin est magnifi´┐Ż car proche parent de l´┐ŻEucharistie et il r´┐Żjouit le c´┐Żur de l´┐Żhomme. Il garde l´┐Żimage de la consolation pour les afflig´┐Żs et de havre de paix pour les personnes chagrin´┐Żes. Il est donc li´┐Ż ´┐Ż la marginalisation sociale. Il est plus individuel que social s´┐Żil ne fait pas partie de l´┐Żensemble du repas qu´┐Żil doit accompagner ou illustrer. Le vin est consomm´┐Ż par sentiment ´┐Ż┬ánational┬á´┐Ż ´┐Ż le vin et le fromage, image typiquement fran´┐Żaise ´┐Ż on fait son ´┐Żloge si on est Fran´┐Żais, comme on fera celui de la bi´┐Żre si l´┐Żon est Allemand ou Belge, le whisky est consomm´┐Ż par mim´┐Żtisme ou par snobisme.
Quant au caf´┐Ż, il fera son entr´┐Że dans l´┐Żunivers fran´┐Żais au XVIIe si´┐Żcle, appel´┐Ż ´┐Ż┬ále lait des philosophes┬á´┐Ż. Il est consid´┐Żr´┐Ż comme un breuvage noble qui donne de l´┐Żesprit et distingue de l´┐Żivrognerie aristocratique. Sa consommation permettra aux Dames de p´┐Żn´┐Żtrer les cercles intellectuels. Nous voyons l´┐Ż que l´┐Żusage du caf´┐Ż a fait ´┐Żvoluer la soci´┐Żt´┐Ż en permettant un certain progr´┐Żs social et une certaine lib´┐Żralisation des m´┐Żurs.
Dans la soci´┐Żt´┐Ż asiatique, manger a pour but d´┐Ż´┐Żquilibrer les ´┐Żnergies du corps, donc d´┐Żassurer une bonne sant´┐Ż, manger est aussi un acte culturel qui a un sens et une valeur m´┐Żtaphorique. Lors d´┐Żun banquet d´┐Żanniversaire, la consommation de nouilles signifie que l´┐Żon souhaite longue vie ´┐Ż la personne, l´┐Żaliment appara´┐Żt l´┐Ż comme vecteur et message de bon augure. Mettre sur la table des boulettes de riz farcies ´┐Ż d´┐Żguster indique une certaine coh´┐Żsion sociale et familiale. Une table asiatique doit respecter les r´┐Żgles des trois sens┬á: la vue, l´┐Żodorat et le go´┐Żt┬á; ´┐Ż cela il faut joindre les cinq saveurs de base┬á: l´┐Żacide, le piquant, l´┐Żamer, le sucr´┐Ż et le sal´┐Ż et pour bien faire le repas doit alterner le croquant, le fondant, le gluant et le sec.
Le repas asiatique doit ´┐Żtre pr´┐Żsent´┐Ż ensemble, sans succession dans le temps. Il est appr´┐Żhend´┐Ż d´┐Żun seul coup d´┐Ż´┐Żil avec ses vari´┐Żt´┐Żs de couleurs et ses nuances de saveurs. Ainsi le convive peut choisir ce qui lui pla´┐Żt, quand il lui pla´┐Żt afin de savourer ´┐Ż sa convenance. Tout est l´┐Ż, tout est ordonn´┐Ż dans l´┐Żespace et non dans le temps. Le repas sert ´┐Ż renforcer les relations sociales, le moment o´┐Ż l´┐Żon ´┐Żchange, o´┐Ż l´┐Żon se parle car il est mals´┐Żant de manger en silence.
Les Chinois utilisaient autrefois des couteaux. Ils furent bannis de la table en faveur des baguettes, suite ´┐Ż un changement de pouvoir. Pour marquer cette rupture, les lettr´┐Żs interdirent l´┐Żusage du couteau. On voit l´┐Ż l´┐Ż´┐Żvolution d´┐Żun usage de table┬á: on passe des couteaux aux baguettes, ce qui n´┐Żest pas le fait du hasard mais correspond ´┐Ż l´┐Ż´┐Żvolution sociale et politique de la soci´┐Żt´┐Ż chinoise.
Manger dans un plat central avec les doigts mais en respectant un code strict, manger ce qui se pr´┐Żsente devant soi en utilisant trois doigts pour tremper le pain dans la sauce, ne jamais se l´┐Żcher les doigts, en ob´┐Żissant ´┐Ż un rythme dans le temps et en se concentrant sur la nourriture, sont l´┐Ż d´┐Żautres fa´┐Żons de se comporter vis-´┐Ż-vis de la nourriture┬á: ce qui correspond ´┐Ż une certaine pratique culturelle m´┐Żditerran´┐Żenne (plus particuli´┐Żrement au Maghreb). Ici on mange en silence car la nourriture est sacr´┐Że. Il faut lui consacrer de l´┐Żattention et du temps.
Aujourd´┐Żhui l´┐Żaliment que l´┐Żon nous impose a pour crit´┐Żre la r´┐Żgularit´┐Ż, la dur´┐Że de conservation, l´┐Żapport calorique, laissant de c´┐Żt´┐Ż les anciennes qualit´┐Żs tels la saveur, le go´┐Żt, la tradition, le plaisir´┐Ż
L´┐Żhomme s´┐Żest ´┐Żvertu´┐Ż durant des si´┐Żcles ´┐Ż diversifier son alimentation┬á; il fait aujourd´┐Żhui marche arri´┐Żre en r´┐Żalisant une alimentation toujours plus homog´┐Żne De ce fait, l´┐Żaliment se trouve d´┐Żconnect´┐Ż du corps social et culturel qui faisait sa diversit´┐Ż, sa pluralit´┐Ż, sa frugalit´┐Ż. Ce n´┐Żest pas l´┐Żaliment qui fait l´┐Żhomme, mais l´┐Żhomme qui cr´┐Że son alimentation.
Il nous faut donc, parfois, r´┐Żapprendre ´┐Ż manger, ´┐Ż passer ´┐Ż table pour donner sens ´┐Ż notre alimentation. Sans cela, nous risquons de faire, sans nous en rendre compte, de ´┐Ż┬ál´┐Żautisme alimentaire┬á´┐Ż Nous aurons droit ´┐Ż l´┐Żaliment id´┐Żal virtuel sans risque, sans saveur, un aliment passe-partout Alors la multifonctionnalit´┐Ż du repas nous appara´┐Żtra artificiellement, comme des collages d´┐Żactes simultan´┐Żs mais incoh´┐Żrents, c´┐Żest-´┐Ż-dire des fonctionnalit´┐Żs d´┐Żrisoires sans aucun contenu.
L´┐Żalimentation est donc contingent´┐Że, ce qui lui enl´┐Żve toute fonction de m´┐Żdiation qui en faisait un ´┐Żl´┐Żment indispensable dans le rapprochement entre individus. On ne fera jamais dispara´┐Żtre la charge affective, ´┐Żmotionnelle et curative que nous pr´┐Żtons aux aliments. Nos ´┐Żmotions, nos souvenirs, notre histoire personnelle sont li´┐Żs ´┐Ż l´┐Żalimentation.
D´┐Żj´┐Ż en 1542, Landi Guillo chantait des hymnes ´┐Ż la gloire du fromage en des termes ´┐Żloquents┬á:
´┐Ż┬áFromage, c´┐Żest le premier aliment humain
M´┐Żpris´┐Ż par les seuls gens aveugles et grossiers,
Qui disent que c´┐Żest un repas de vilains,
Parce que sa force endurcit les os
Moi, je ne vois pas que l´┐Żhomme sans en manger,
Puisse ´┐Żtre d´┐Żune vigueur achev´┐Ż┬á!┬á´┐Ż
Notre alimentation est le v´┐Żhicule de nos symboles, elle conditionne nos vies et occupe nos esprits, elle nous procure des sensations┬á; elle est donc essentielle ´┐Ż notre vie et ´┐Ż notre progr´┐Żs. Sans alimentation, l´┐Żhomme serait nu┬á: comme il choisit son v´┐Żtement, il choisit son alimentation, c´┐Żest ce qui le distingue et le singularise et lui est n´┐Żcessaire pour vivre et pour exister.
Awad Fouatih, le 15/05/01Accueil ´┐Ż Retour vers le haut de page
Envoyez vos commentaires et vos questions au r´┐Żgisseur du site. Copyright ´┐Ż ´┐Ż 1997 Lierre & Coudrier ´┐Żditeur