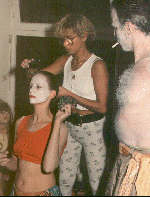Rites et organisation sociale
|
|
Pr´┐Żambule
Depuis que l'ethnologie et l'anthropologie se sont d´┐Żbarrass´┐Że des miasmes moraux ou religieux qui pr´┐Żsidaient ´┐Ż leur cr´┐Żation, l'on n'a trouv´┐Ż aucune soci´┐Żt´┐Ż, aucun groupe humain dont l'activit´┐Ż se bornerait ´┐Ż ne cr´┐Żer que des r´┐Żsultats utilitaires. Les membres de chaque soci´┐Żt´┐Ż accomplissent toujours ´┐Ż un moment o´┐Ż ´┐Ż un autre des actes "cod´┐Żs" dont la finalit´┐Ż n'est pas imm´┐Żdiate ou manifeste (cf. H. Leroy-Gourhan in Les religions de la pr´┐Żhistoire).
Peut-´┐Żtre le rite se d´┐Żfinit-il surtout pour l'Occidental en termes d'inutilit´┐Ż. Il serait plus juste d'affirmer que le rite est un acte dont l'efficacit´┐Ż ne s'´┐Żpuise pas dans l'encha´┐Żnement empirique des causes et des effets. Le rite se rep´┐Żre surtout ´┐Ż son caract´┐Żre r´┐Żp´┐Żtitif et immuable. Il recouvre une s´┐Żrie d'actions tr´┐Żs pr´┐Żcises, accomplies ´┐Ż un moment particulier et dans un ordre d´┐Żtermin´┐Ż qui varie en fonction de crit´┐Żres eux-m´┐Żmes contr´┐Żlables. "On peut donc appeler rite un acte qui se r´┐Żp´┐Żte et dont l'efficacit´┐Ż est, au moins en partie, d'ordre extra-empirique."
L'on a souvent fait remarquer que le rite est ce qui diff´┐Żrencie l'´┐Żtre humain de l'animal : "Tandis que le comportement animal est en grande partie dict´┐Ż par l'instinct (c'est-´┐Ż-dire par des r´┐Żgles communes ´┐Ż l'esp´┐Żce), au contraire l'homme doit se choisir lui-m´┐Żme ses r´┐Żgles la plupart du temps." Bergson a consid´┐Żr´┐Ż ces r´┐Żgles comme une sorte de pseudo-instinct. D'autres ´┐Żcoles (psychologie moderne) insistent sur la n´┐Żcessit´┐Ż des humains a ´┐Żtablir des r´┐Żgles bridant leur individualit´┐Ż, de fa´┐Żon a apaiser l'angoisse que provoque la conscience.
L'humain tenterait d'imiter l'ordre immuable de la nature afin d'y trouver sa propre coh´┐Żrence, " l'angoisse mesurant la distance entre la r´┐Żgle et l'instinct v´┐Żritable, entre la nature et la culture. " Certains rites ont donc pu na´┐Żtre du d´┐Żsir de pr´┐Żserver la vie de toute atteinte de l'impr´┐Żvu. Le sentiment de ce qui menace l'ordre c'est l'angoisse mais en m´┐Żme temps la perception d'un inconnu : c'est le sens du surnaturel, du numineux.
Le terme de numineux est une cr´┐Żation de Rudolph Otto 1. Il englobe les notions de mana ou de sacr´┐Ż.
Le numineux correspond pour lui a un sentiment originaire et sp´┐Żcifique, il ´┐Żvoque une impression directe, une r´┐Żaction spontan´┐Że devant une puissance qui, apr´┐Żs coup, pourra ´┐Żtre jug´┐Że surnaturelle. Le premier caract´┐Żre du numineux, selon Otto, c'est qu'il est myst´┐Żrieux. Et il ajoute : " Or, le mysterium est ´┐Ż la fois tremendum et fascinans. " Il ´┐Żvoque pour l'´┐Żtre humain aussi bien le danger du chaos que la puissance du surnaturel.
Jean Cazeneuve, dans Sociologie du rite, prend en compte la psychanalyse dans sa capacit´┐Ż ´┐Ż comprendre, non le fait m´┐Żme de la r´┐Żaction humaine face au numineux, mais pourquoi la collectivit´┐Ż a recours ´┐Ż telle action symbolique plut´┐Żt qu'´┐Ż une autre. Autre probl´┐Żme soulev´┐Ż par le point de vue psychanalytique : la difficult´┐Ż ´┐Ż rendre compte de l'aspect social du rite, la psychanalyse s'´┐Żtant b´┐Żtie sur l'observation de ph´┐Żnom´┐Żnes individuels (les maladies mentales). Cela vaut pour l'´┐Żcole freudienne par pour la plupart des autres courants de la psychanalyse. " Or [...] la condition humaine ne peut ´┐Żtre ritualis´┐Że que dans le cadre social. "
Durkheim consid´┐Żre que le groupe social ´┐Ż au moins ´┐Ż ses d´┐Żbuts ´┐Ż ne peut se maintenir qu'en se repr´┐Żsentant ´┐Ż lui-m´┐Żme sous une forme symbolique dont le rite serait charg´┐Ż de consolider l'efficacit´┐Ż. Cette th´┐Żorie est cependant trop r´┐Żductrice, elle assimile trop vite le sacr´┐Ż´┐Ż au social. En fait, il s'agit l´┐Ż de la mise en ´┐Żvidence du r´┐Żle indispensable de la fonction symbolique, qui permet de cr´┐Żer une dialectique entre les diff´┐Żrentes "couches" de la psych´┐Ż.
J. C. en revient ´┐Ż son hypoth´┐Żse de d´┐Żpart, qui est que le rite sert ´┐Ż cercler l'univers humain, ´┐Ż lui permettre d'´┐Żtablir un lien entre " l'univers de la r´┐Żgle et la puissance inqui´┐Żtante du numineux. " " La fonction du rite est complexe, et m´┐Żme contradictoire. On pourrait dire qu'elle est dialectique. [...] Le rituel r´┐Żpond probablement ´┐Ż la fois au probl´┐Żme bergsonien de la rupture d'´┐Żquilibre due aux insuffisances de l'instinct chez l'homme (donc aux conflits provoqu´┐Żs par l'humanit´┐Ż ´┐Ż "moiti´┐Ż ange et moiti´┐Ż b´┐Żte" ´┐Ż de l'homme), au probl´┐Żme psychanalytique des conflits endo-psychiques ou, si l'on pr´┐Żf´┐Żre, des contradictions inconscientes de la nature humaine, et au probl´┐Żme sociologique de l'int´┐Żgration de l'individu dans le groupe [...] (le rite) permet ´┐Ż l'homme de se situer symboliquement entre les deux p´┐Żles du conditionn´┐Ż et de l'inconditionn´┐Ż ", c'est-´┐Ż-dire de la condition humaine et du numineux. Le rite va donc remplir trois fonctions :
- prot´┐Żger l'homme du danger repr´┐Żsent´┐Ż par le numineux (qui peut d´┐Żstructurer l'organisation humaine) ; [rites - tabou] ;
- permettre ´┐Ż l'homme d'entrer en contact avec la puissance du numineux et donc d'acqu´┐Żrir cette puissance [rites magiques] ;
- tenter d'´┐Żtablir une synth´┐Żse entre le monde profane et le monde sacr´┐Ż [rites religieux].
Hypoth´┐Żse sur le rite
L'on pourrait s'amuser ´┐Ż remplacer le terme de numineux par celui d'inconscient. Il serait alors possible, par un jeu de rebond, de remplacer le terme de "rite", qui permet d'´┐Żtablir une synth´┐Żse entre ces deux mondes (ou de prot´┐Żger l'homme, ou de lui permettre d'y p´┐Żn´┐Żtrer) par .., la psychanalyse ! ... Ce qui reviendrait, selon la th´┐Żse d´┐Żfendue par Jean Cazeneuve, ´┐Ż consid´┐Żrer la psychanalyse comme une religion moderne.., et les diff´┐Żrents courants psychanalytiques comme des fa´┐Żons diff´┐Żrentes d'aborder l'inconscient : la th´┐Żorie freudienne semble plus orient´┐Że du c´┐Żt´┐Ż d'une vision tremendum du numineux, puisque Freud parle du sentiment "d'inqui´┐Żtante ´┐Żtranget´┐Ż", et qu'il a b´┐Żti sa th´┐Żorie sur le tabou de l'inceste.
Jung, au contraire, ´┐Ż qui consid´┐Żre l'action th´┐Żrapeutique comme le retour d'un dialogue avec les forces inconscientes ´┐Ż se situe plus du c´┐Żt´┐Ż fascinans du numineux.
L'on con´┐Żoit alors pourquoi ces deux hommes ont eu du mal ´┐Ż s'entendre...
Mais, plus loin qu'un d´┐Żbat entre deux hommes, th´┐Żoriciens de la psychanalyse, ce sont deux visions, deux repr´┐Żsentations du monde qui s'affrontent ´┐Ż travers ces deux pionniers. Et cet affrontement se prolonge ´┐Ż travers les ´┐Żcoles et les courants de pens´┐Żes que chacun a fait na´┐Żtre.
Le numineux n'est-il pas tremendum et fascinans ? Cette conjonction de R. Otto, collaborateur de Freud, est lourde de cons´┐Żquences au plan conceptuel. L'Inconscient, dans son immense ambivalence, ne pourrait-il pas ´┐Żtre autant mena´┐Żant que transcendant ? Partageant l'Homme entre deux ´┐Żlans : peur et fascination.
Or la pratique nous am´┐Żne ´┐Ż concevoir que la peur est indissolublement li´┐Ż ´┐Ż une fonction transcendante.2 Il nous faut alors accueillir la peur comme une compagne charg´┐Że de significations bien plus importantes que celles que l'on a coutume de lui attribuer.
D'apr´┐Żs Bersgon," 3 les croyances et pratiques religieuses ou magiques ont une fonction essentielle : remplacer l'instinct qui fait d´┐Żfaut chez l'homme. Mais pour Bergson, c'est pour arr´┐Żter les ravages de l'intelligence que la nature, ou plus exactement l'´┐Żlan vital, suscite des habitudes qui tiennent lieu d'instinct.
[...] Ce que la vie ferait surgir dans l'homme pour lutter contre la force dissolvante de l'intelligence, ce seraient d'abord les repr´┐Żsentations hallucinatoires, de sorte que la fonction envisag´┐Że est d'abord celle de la fabulation.
[...] Selon Bergson, les rites religieux ont pour fonction de remplacer la nature instinctive d´┐Żfaillante, min´┐Że par l'intellect, et d'instituer des habitudes sociales qu'on ne discute pas, afin de donner ´┐Ż l'homme la confiance dans ses entreprises. "
On a reproch´┐Ż parfois ´┐Ż cette th´┐Żorie de s´┐Żparer la fonction fabulatrice de l'intelligence et m´┐Żme de cr´┐Żer entre elles une opposition radicale. En outre, force est de constater que les rites brident les instinct plus souvent qu'ils ne se substituent ´┐Ż eux. D'autre part, pourquoi les rites sont-ils plus exigeants dans les soci´┐Żt´┐Żs les moins ´┐Żvolu´┐Żes ?
Sans adh´┐Żrer ´┐Ż l'une de ces deux th´┐Żories extr´┐Żmes, l'on peut retenir leur point de d´┐Żpart, " ´┐Ż savoir que la fonction du rituel pourrait correspondre ´┐Ż certains besoins n´┐Żs du fait m´┐Żme que l'humanit´┐Ż d´┐Żpasse l'animalit´┐Ż. " La solution se trouverait donc dans la pr´┐Żsence de conflits instinctuels li´┐Żs ´┐Ż la condition humaine. Comme les psychanalystes, l'on pourrait alors parler de maladie de l'instinct.
Pour Freud, la naissance du rite co´┐Żncide avec l'´┐Żmergence de la culture. Il consid´┐Żre les pratiques magiques comme " une utilisation erron´┐Że de l'association des id´┐Żes ". La magie se r´┐Żduit pour lui au principe de la " toute-puissance " des id´┐Żes. Il s'interroge surtout sur les rites dits n´┐Żgatifs (les tabous). " La prohibition qu'implique ce genre de rite porte soit directement, soit le plus souvent par d´┐Żplacement, sur un acte qui correspond dans l'inconscient ´┐Ż un d´┐Żsir. Les primitifs ont donc ´┐Ż l'´┐Żgard de leurs interdits rituels une "attitude ambivalente " ; "Leur inconscient serait heureux d'enfreindre ces prohibitions, mais ils craignent de le faire, et ils le craignent parce qu'ils voudraient le faire et la crainte est plus forte que le d´┐Żsir " 4 . Cette ambivalence, qui se retrouve dans le tabou comme dans la n´┐Żvrose obsessionnelle que Freud a ´┐Żtudi´┐Że, est li´┐Że ´┐Ż un ´┐Żtat d'angoisse : c'est la libido des d´┐Żsirs refoul´┐Żs qui se transforme en angoisse. La religion devient donc pour Freud une sorte de " n´┐Żvrose universelle de l'humanit´┐Ż ". Mais il faut se rappeler que pour Freud la n´┐Żvrose est un moindre mal puisqu'elle permet ´┐Ż l'homme de conserver une certaine coh´┐Żrence en attendant la r´┐Żsolution des conflits internes.
Dans le mythe d'origine ´┐Żlabor´┐Ż par Freud, les fils se sont r´┐Żvolt´┐Żs contre le p´┐Żre et l'ont tu´┐Ż, puis d´┐Żvor´┐Ż, pour ensuite conserver les lois qu'il avait institu´┐Żes. Pour Freud, l'ambivalence est la cl´┐Ż du probl´┐Żme : le tabou devient alors symbole de la tendance r´┐Żpressive, le repas tot´┐Żmique r´┐Żalisant au contraire symboliquement la tendance r´┐Żprim´┐Że. Le rituel comporterait alors deux sens oppos´┐Żs : " prohiber ce qui entra´┐Żne la culpabilit´┐Ż angoissante, ou, au contraire, s'y adonner dans certaines conditions. Et ces deux sens auraient la m´┐Żme fonction : permettre ´┐Ż l'humanit´┐Ż de supporter le conflit entre les forces r´┐Żpressives et les impulsions, qui est ´┐Ż l'origine de son propre av´┐Żnement. "
L'un des probl´┐Żmes soulev´┐Żs par cette th´┐Żorie est qu'elle postule l'h´┐Żr´┐Żdit´┐Ż des caract´┐Żres acquis, alors que cela est loin d'´┐Żtre prouv´┐Ż par la biologie.
D'autre part, Freud semble faire ´┐Żmerger la culture d'une situation qui est d´┐Żj´┐Ż culturelle. Et Malinovski affirme que la situation ´┐Żdipienne n'existe pas dans les soci´┐Żt´┐Żs matriarcales; elle serait donc la cons´┐Żquence et non la cause d'un syst´┐Żme social.
" Il est facile de voir qu'apr´┐Żs avoir dou´┐Ż la horde primitive de tous les d´┐Żfauts, de tous les travers, de toutes les inadaptations qui caract´┐Żrisent une famille europ´┐Żenne des classes moyennes, Freud l'a lanc´┐Że dans la jungle pr´┐Żhistorique o´┐Ż il la laisse d´┐Żcha´┐Żner ses passions. " 5
Levi-Strauss am´┐Żne un point fort int´┐Żressant sur la th´┐Żorie freudienne. Selon lui, les c´┐Żr´┐Żmonies comm´┐Żmoratives du parricide et le repas tot´┐Żmique ne seraient pas des comm´┐Żmorations d'actes ayant eu lieu, mais au contraire une mani´┐Żre de r´┐Żaliser un d´┐Żsir qui n'aurait jamais ´┐Żt´┐Ż r´┐Żalis´┐Ż. Il parle de " l'expression permanente d'un d´┐Żsir de d´┐Żsordre, ou plut´┐Żt de contre-ordre ".
Il est vrai que le point d'achoppement de la th´┐Żorie freudienne se trouve ´┐Żvidemment dans le fait qu'elle base le fondement de tous les rites dans un ´┐Żv´┐Żnement historique.
Geza Roheim, lui, tout en gardant sienne la th´┐Żorie ´┐Żdipienne, la consid´┐Żre sous un tout autre angle. Selon lui, le complexe ´┐Żdipien fait partie de l'´┐Żvolution naturelle de la psych´┐Ż qui passe par des phases n´┐Żcessaires au cours de son d´┐Żveloppement. Contrairement ´┐Ż ce que soutient Malinovski, la forme sociale de la famille ne modifie pas la situation en question. Le fondement du complexe est d'ordre biologique. Cette th´┐Żorie rejoint celle de Lacan. Toutes deux reposent sur l'id´┐Że d´┐Żcrite par Bolk de " processus de f´┐Żtalisation ", qui fait intervenir le d´┐Żcalage qui existe entre " le soma et le germen ".
L'enfant poss´┐Żderait un d´┐Żsir sexuel ´┐Ż un ´┐Żge o´┐Ż il n'est pas biologiquement capable de se satisfaire. "... les ´┐Żtres humains ont un complexe d'´┐Żdipe, simplement parce que nous voulons ´┐Żtre adultes quand nous sommes errants. "6
Place du rite
Il existe alors deux sortes de rites, " ceux qui prot´┐Żgent l'individu contre le contact au numineux, et ceux qui tentent de capter ou de manier la force du numineux. " " En d´┐Żfinitive, ou bien l'on veut fixer la condition humaine dans un syst´┐Żme stable en l'entourant de r´┐Żgles, et alors on a recours ´┐Ż des rites pour ´┐Żcarter de ce syst´┐Żme tout ce qui symbolise son imperfection ; ou bien on se place symboliquement dans le monde de la puissance absolue, irr´┐Żductible ´┐Ż la r´┐Żgle, et alors il n'y a plus ´┐Ż proprement parler de "condition " humaine. " " Cependant, la condition humaine fix´┐Że par les r´┐Żgles reste une cr´┐Żation artificielle, elle ne repose en fin de compte que sur l'homme lui-m´┐Żme. " Ce qui ´┐Żchappe ´┐Ż la r´┐Żgle, ce qui se manifeste comme exceptionnel est donc plus r´┐Żel et se suffit ´┐Ż soi-m´┐Żme. " Il est donc naturel qu'on ait ´┐Żprouv´┐Ż le besoin de r´┐Żsoudre l'opposition entre [...] l'ordre et la puissance, par une synth´┐Żse qui, elle aussi, ne pouvait se r´┐Żaliser que symboliquement. Il fallait pour cela recourir ´┐Ż des rites qui donnassent ´┐Ż la condition humaine un autre fondement qu'elle-m´┐Żme, la fissent participer ´┐Ż une r´┐Żalit´┐Ż transcendante. C'´┐Żtait s'engager sur la voie de la religion. " J. Cazeneuve d´┐Żfinit donc la religion comme une tentative pour relier deux mondes. Et, certes, le terme religion vient du latin religare qui signifie relier. Il propose trois "solutions" laiss´┐Żes ´┐Ż l'humain face ´┐Ż l'angoisse de son humanit´┐Ż : " Dans la premi´┐Żre solution, le numineux devait ´┐Żtre ´┐Żcart´┐Ż comme une impuret´┐Ż ; dans la deuxi´┐Żme, il devait ´┐Żtre mani´┐Ż comme un principe de puissance magique, et dans la troisi´┐Żme enfin, il se pr´┐Żsentait avec le caract´┐Żre supra-humain de ce qui est sacr´┐Ż, de ce qui est au c´┐Żur des religions. " Les rites pourraient alors ´┐Żtre (re)d´┐Żfinis comme " les r´┐Żactions possibles de l'humanit´┐Ż en face de son propre myst´┐Żre. "
Quelques aper´┐Żus th´┐Żoriques
Selon Malinowski, la raison primordiale des rites est " une sorte de r´┐Żplique de l'instinct, une des cr´┐Żations de l'intelligence pour suppl´┐Żer les r´┐Żgles instinctives qui lui font d´┐Żfaut. " Cette th´┐Żorie, qui est applicable pour les tabou, est cependant discutable. D'apr´┐Żs J. Cazeneuve, Malinovsky semble avoir ´┐Żlabor´┐Ż sa th´┐Żorie en opposition ´┐Ż celle de Freud. L´┐Ż o´┐Ż Freud parlait d'une action de la libido sur les habitudes sociales, Malinovsky a oppos´┐Ż celle de l'intelligence. Mais comment interpr´┐Żter alors les rites orgiaques, par exemple ?
Bibliographie provisoire
- BASTIDE R. Les religions africaines au Br´┐Żsil, PUF, 1960.
- COMMENGE B. La danse de Nietzsche, L'infini, Gallimard, 1988.
- DE CERTEAU M. La possession de Loudun, Julliard, 1970.
- DE MARTINO E. La terre du remords, Gallimard, 1966.
- Ladakh, de la transe ´┐Ż l'extase, Peuples du Monde, 1988.
- LEVY-BRUHL L. La mentalit´┐Ż primitive, Alcan, 1925.
- METRAUX A. Le vaudou haitien, Gallimard, 1957.
- OTTIN M. et BENSA A. Le sacr´┐Ż ´┐Ż Java et Bali, R.Laffont, 1 969 .
- SCHOTT-BILLMANN F. Possession, danse et th´┐Żrapie, Sand, 1985.
- Danse, mystique et psychanalyse, Chiron, 1987.
Le primitivisme en danse, Chiron, 1989.Anne Rose, Paris 1992
Notes :
1 - R. Otto, Le sacr´┐Ż, Petite Biblioth´┐Żque Payot, p. 22.
2 - Ce terme a ´┐Żt´┐Ż forg´┐Ż par C. G. Jung pour repr´┐Żsenter cette puissance qui, en l'Homme, le pousse, quelque soient les circonstances, ´┐Ż se hisser au-dessus de la gangue noir´┐Żtre des bas-fonds inconscients pour atteindre la lumi´┐Żre de la Conscience.
3 - Henri Bergson, Les deux sources de la morale et de la religion, Alcan, Paris, 1930.
4 - Sigmund Freud, Totem et tabou, Payot, Paris, 1947.
5 - Malinovski, La sexualit´┐Ż et sa r´┐Żpression dans les soci´┐Żt´┐Żs primitives, Payot, Paris, 1932.
6 - Geza Roheim, The Oedipus complex, magic and culture, (in Psychoanalysis and the social sciences), International Universities Press, New-York, 1950.
Plan
du site ´┐Ż Vers le le haut de page
Vos commentaires et questions au r´┐Żgisseur du site.
´┐Ż´┐Ż ´┐Ż 1997 Lierre & Coudrier ´┐Żditeur