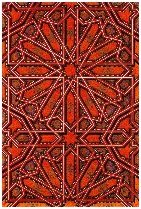|
| ||
|
Le mythe, la raison et nous
| ||
|
| ||
|
Les mythes ont toujours fait couler beaucoup d'encre. Chacun y va de son grain de sel et de sa science pour tenter de leur donner un sens et de r´┐Żpondre ´┐Ż la question : pourquoi une telle p´┐Żrennit´┐Ż ? Des th´┐Żories s'´┐Żlaborent, s'´┐Żchauffent, s'´┐Żchafaudent historique, sociologique... ethnologique et m´┐Żme psychanalytique, mais elles restent insuffisantes, parce que parcellaires pour r´┐Żpondre ´┐Ż la question : en quoi le mythe parle-t-il de la profondeur de l'homme? L'´┐Żtude d'un mythe est pareil au parcours des h´┐Żros eux-m´┐Żmes : jalonn´┐Ż d'´┐Żpreuves. Le premier ´┐Żcueil se pr´┐Żsente dans la mani´┐Żre d'envisager les personnages : assimiler chaque personnage ´┐Ż un ´┐Żtre de chair et d'os. Or le mythe n'est pas un ph´┐Żnom´┐Żne individuel, mais une cr´┐Żation collective qui s´┐Ż´┐Żlabore sur une longue ´┐Żchelle de temps. A ce titre, ses personnages repr´┐Żsentent des instances de la psych´┐Ż humaine, qui plus est sur plusieurs couches d´┐Żhistoire voire de civilisation. R´┐Żduire un h´┐Żros mythique ´┐Ż un individu revient, pour celui qui ´┐Żcrit sur le mythe, ´┐Ż s'identifier t´┐Żt ou tard avec le personnage/h´┐Żros en question. D´┐Żs lors, la n´┐Żcessaire distance avec l'objet d'´┐Żtude n'existe plus; l'on n'est plus le sujet qui m´┐Żdite sur un objet : l'objet envahit le sujet. Et nous voici habit´┐Żs par le mythe. Le pi´┐Żge collectif se referme sur l'auteur. D'autant plus qu'il est clair que mythographier signifie pour l'auteur qu'il a quelque chose ´┐Ż voir avec ce mythe, qu'il est impliqu´┐Ż. Aussi la premi´┐Żre question ´┐Ż se poser est-elle : en quoi suis-je concern´┐Ż par ce mythe ? Quelle instance de ma personnalit´┐Ż r´┐Żsonne avec lui ? Qu'est-ce que cela touche en moi ? C'est ´┐Ż ce point que le travail commence et l'on ne peut pr´┐Żtendre avancer sur le chemin de l'´┐Żtude rationnelle du mythe sans avoir per´┐Żu une amorce de r´┐Żponse ´┐Ż cette question initiale. Le mythe a sa vie propre, son mouvement, sa logique; les personnages qu'il met en sc´┐Żne ´┐Żgalement, et l'ensemble franchit les limites de l'humain : c'est pourquoi il est impossible de prendre les h´┐Żros mythiques comme mod´┐Żles de comportements humains : un meurtre, un sacrifice a sa raison d'´┐Żtre dans le r´┐Żcit mythologique, dans la r´┐Żalit´┐Ż de tous les jours. Pour un individu donn´┐Ż, le m´┐Żme acte serait r´┐Żv´┐Żlateur d'une pathologie. Dans les soci´┐Żt´┐Żs traditionnelles, on le dit poss´┐Żd´┐Ż par un d´┐Żmon; dans notre soci´┐Żt´┐Ż, nous dirions , avec Jung, qu'il est sous l´┐Żemprise d'un complexe autonome [1] Si l'on parle de complexe autonome, on aborde d´┐Żj´┐Ż un aspect de la psych´┐Ż, mais le terme reste tr´┐Żs g´┐Żn´┐Żrique. Dans le r´┐Żcit mythique la r´┐Żalit´┐Ż d´┐Żcrite n'est pas la r´┐Żalit´┐Ż physique objective, c'est la r´┐Żalit´┐Ż de la psych´┐Ż. Aussi chaque personnage repr´┐Żsente-t-il non pas un individu de chair et d'os, mais une facette de la psych´┐Ż collective totale. Or celle-ci n'est pas un bloc monolithique, mais une masse d'´┐Żnergie en perp´┐Żtuel mouvement, tendue , sous tendue, articul´┐Że selon deux p´┐Żles dialectiques (polaris´┐Że) : conscient/inconscient ; masculin/f´┐Żminin. Ainsi, chaque personnage du mythe repr´┐Żsente-t-il une facette particuli´┐Żre de la psych´┐Ż. Un personnage f´┐Żminin, par exemple, ne peut-il repr´┐Żsenter qu'un f´┐Żminin collectif, ´┐Ż situer selon la quaternit´┐Ż propos´┐Że par Jung[2] ? Il rev´┐Żt ainsi une quantit´┐Ż presque infinie d'aspects : L'´┐Żl´┐Żment maternel ´┐Ż l'autorit´┐Ż magique du f´┐Żminin ´┐Ż la sagesse ´┐Ż l'´┐Żl´┐Żvation spirituelle au del´┐Ż de l'intellect ´┐Ż ce qui est bon -protecteur, patient, ce qui soutient ´┐Ż ce qui favorise la croissance ´┐Ż la f´┐Żcondit´┐Ż ´┐Ż l'alimentation ´┐Ż le lieu de la transformation magique ´┐Ż de la renaissance ´┐Ż l'instinct ou l'impulsion secourable ´┐Ż ce qu'il y a de sacr´┐Ż, de cach´┐Ż d'obscur ´┐Ż l'ab´┐Żme, le monde des morts, ce qui d´┐Żvore, ce qui s´┐Żduit ce qui empoisonne, ce qui provoque l'angoisse, l'in´┐Żluctable . ´┐Ż [3] ´┐Ż ´┐Ż ... les mythes et les contes de la litt´┐Żrature universelle renferment les th´┐Żmes bien d´┐Żfinis qui reparaissent partout et toujours. Nous rencontrons ces m´┐Żmes th´┐Żmes dans les fantaisies, les r´┐Żves, les id´┐Żes d´┐Żlirantes et les illusions des individus qui vivent aujourd'hui. Ce sont ces images et ces correspondances typiques que j'appelle repr´┐Żsentations arch´┐Żtypiques... Elles nous impressionnent, nous influencent, nous fascinent. Elles ont leur origine dans l'arch´┐Żtype, qui, lui-m´┐Żme ´┐Żchappe ´┐Ż la repr´┐Żsentation, forme pr´┐Ż-existante et inconsciente... ´┐Ż C. G. Jung in Aspect du drame contemporain.
Catherine Barb´┐Ż, le 12/11/1991
Le mythe, le f´┐Żminin et notre conscienceIllel Kieser pose le principe d'une conscience blanche occidentale qui se pose comme universelle alors qu'il existerait dix ou douze autres formes de conscience possibles, ´┐Ż chacune pouvant ´┐Żtre qualifi´┐Że de la m´┐Żme fa´┐Żon que la n´┐Żtre ´┐Ż. Parlant de f´┐Żminitude et de n´┐Żgritude, il se demande si ce ne sont pas l´┐Ż des concepts ´┐Ż commodes pour une doctrine de la domination ´┐Ż. ´┐Ż l'homme blanc, au nom de tous les pouvoirs, y compris psychiques, s'est arrog´┐Ż le droit ´┐Ż l'exclusion de toutes les autres formes de repr´┐Żsentation du monde. ´┐Ż Ainsi, une ´┐Żtude critique de l'histoire r´┐Żcente de la psychologie montre que la m´┐Żre, la g´┐Żnitrice,
a ´┐Żt´┐Ż longtemps prise dans un faisceau de projections qui a fait d'elle une sorte de personnage
omnipotent, donneur de vie, dispensateur de chaleur et de nourriture mais aussi capable de nuisances
graves ´┐Ż l'´┐Żgard de l'enfant. Que n'a-t-on pas dit de la m´┐Żre du psychotique ?
Mon hypoth´┐Żse de d´┐Żpart s'inscrit dans la continuit´┐Ż de ce discours, ´┐Ż savoir que M´┐Żd´┐Że est une repr´┐Żsentation d'une des ces formes de conscience collective, rejet´┐Żes dans l'ombre par la conscience masculine au pouvoir, dont l'´┐Żmergence reste ´┐Ż venir. Il m'aurait ´┐Żt´┐Ż plus ais´┐Ż de traiter le mythe sur un mode plus classique et moins original. C'e´┐Żt ´┐Żt´┐Ż confortable et s´┐Żcurisant de pr´┐Żsenter M´┐Żd´┐Że comme une expression de l'Anima, ou m´┐Żme de traiter du probl´┐Żme sur le plan de la conscience f´┐Żminine individuelle. La tentation fut immense de faire machine arri´┐Żre, quand exposant, dans ses grandes lignes, mon projet d'´┐Żcriture ´┐Ż un psychologue clinicien d'ob´┐Żdience jungienne, je re´┐Żus comme un coup de fouet, les manifestations de son incompr´┐Żhension, peut-´┐Żtre feinte... ´┐Ż Conscience f´┐Żminine collective, je ne vois vraiment pas ce que tu veux dire... ´┐Ż C'´┐Żtait une femme, et elle ne comprenait pas. Il est vrai que mon expos´┐Ż ne pouvait ´┐Żtrelumineux, dans la mesure o´┐Ż, avan´┐Żant en terrain vierge, je ne disposais pas de tous les ´┐Żl´┐Żments th´┐Żoriques, ni m´┐Żme du vocabulaire ad´┐Żquat. Comme point de d´┐Żpart ´┐Ż la d´┐Żmonstration, il faudra qualifier pr´┐Żcis´┐Żment la conscience au pouvoir, masculine, blanche, rationnelle, lumineuse et en regard, la conscience f´┐Żminine telle qu'elle transpara´┐Żt dans le personnage mythique : autre, tiss´┐Że d'ombre, barbare, magicienne....
Pourquoi M´┐Żd´┐Że, pourquoi le mythe ?De nos jours, dans la soci´┐Żt´┐Ż occidentale, il semblerait que le mythe ne se vive plus de l'int´┐Żrieur : on glose, on en d´┐Żcortique la symbolique, mais le lien ne se fait plus entre la personne et ces images qui vivent ´┐Ż l'int´┐Żrieur d'elle, sinon pass´┐Żes au crible de la psychanalyse. Autrement en est-il en Inde, en Afrique... Le mythe est justement la premi´┐Żre victime de la rationalisation ´┐Ż outrance de la conscience blanche. Le mythe est tronqu´┐Ż, r´┐Żcup´┐Żr´┐Ż, universalis´┐Ż au profit de l'id´┐Żologie dominante : ainsi ´┐Żdipe. N´┐Żanmoins, le mythe continue ´┐Ż vivre au-dedans de chacun de nous, un rapide tour d'horizon de l'imaginaire de nos contemporains suffit ´┐Ż le prouver. Mais il agit dans l'ombre, parce que non int´┐Żgr´┐Ż ´┐Ż la conscience. Force m'est de retracer l'int´┐Żr´┐Żt que je porte ´┐Ż celui de M´┐Żd´┐Że. Je ne l'ai pas choisi ; il m'a ´┐Żt´┐Ż impos´┐Ż de l'ext´┐Żrieur. J'avais seulement envie de travailler sur un mythe grec dans le cadre d'un m´┐Żmoire de ma´┐Żtrise, il y a treize ans. Et d´┐Żj´┐Ż la force du nom fit son ´┐Żuvre. Mon premier travail, apr´┐Żs avoir pris connaissance du r´┐Żcit mythique fut de le retrouver dans mon histoire et je r´┐Żalisai rapidement que nos chemin s'´┐Żtaient crois´┐Żs depuis ma naissance. D´┐Żs lors, ce fut la fascination, j'´┐Żtais m´┐Żd-us´┐Że. avant l'heure Force du nom, M´┐Żd´┐Że, M´┐Żduse : m´┐Żme racine ´┐Żtymologique, en relation avec l'acte de penser, de m´┐Żditer. Et imm´┐Żdiatement le renvoi ´┐Ż ma propre difficult´┐Ż ´┐Ż organiser ma pens´┐Że : confusion du thumos et des bouleumata, du centre du sentiment et de celui de la volont´┐Ż : centre du d´┐Żbat chez le personnage lorsqu'il s'agit de prendre la d´┐Żcision de sacrifier ses enfants. Et puis derri´┐Żre cette racine officielle, une autre hypoth´┐Żse, r´┐Żfut´┐Że par les sp´┐Żcialistes la racine Med- aurait ´┐Ż voir avec les testicules, r´┐Żservoir de sperme. Pourquoi ne pas tenter une incursion de ce c´┐Żt´┐Ż, alors qu'il est si souvent question du lit dans le texte d'Euripide. La M´┐Żd´┐Że d'Euripide, pourquoi cette trag´┐Żdie plut´┐Żt qu'une autre, alors que le mythe est constitu´┐Ż de toutes les versions auxquelles il a donn´┐Ż lieu ? Parce que c'est la premi´┐Żre dont le texte nous soit parvenu intact, avec cette difficult´┐Ż que la version qu'elle propose est d´┐Żj´┐Ż largement rationalis´┐Że, par rapport aux bribes qui nous restent de textes ant´┐Żrieurs. Mais il subsiste dans le texte des zones d'ombres, et c'est dans ces failles ´┐Ż la logique rationnelle que je me propose de plonger. Au-del´┐Ż de cette ´┐Żuvre, force m'est de retourner, apr´┐Żs quelques ann´┐Żes d'errance et de r´┐Żflexion m´┐Żl´┐Że, de retourner ´┐Ż mon corpus initial, monstrueux pour un m´┐Żmoire de ma´┐Żtrise, n´┐Żcessaire et adapt´┐Ż au pr´┐Żsent travail : M´┐Żd´┐Że, d'Euripide ´┐Ż Pasolini, auquel je pourrais m´┐Żme ajouter aujourd'hui celle de Marie Cardinal. Pasolini a trait´┐Ż deux trag´┐Żdies grecques : ´┐Żdipe et M´┐Żd´┐Że. Fait int´┐Żressant ´┐Ż souligner dans la perspective que j'ai choisie : ´┐Żdipe sur lequel se fonde l'universalit´┐Ż de la conscience blanche dominante, d´┐Żclin´┐Że au masculin ; M´┐Żd´┐Że, femme et barbare. D'Euripide ´┐Ż M.Cardinal, le mythe n'a pas chang´┐Ż de discours : ´┐Ż peine celle d'Anouilh est-elle plus ´┐Ż peuple ´┐Ż, boh´┐Żmienne un tantinet grossi´┐Żre, mais toujours m´┐Żre meurtri´┐Żre. Nous vivons en des temps o´┐Ż le tragique a chang´┐Ż de niveau. Dieu est mort, ecce homo ! Ainsi du Voyage des boh´┐Żmiens, film d'Angelopoulos, reprise de la l´┐Żgende des Atrides. Sans doute serait-il int´┐Żressant de creuser cette tendance des auteurs modernes ´┐Ż transporter les antiques h´┐Żros dans la roulotte des gens du voyage. Pourquoi repr´┐Żsenter ces surhommes, ces demi-dieux sous les traits d'individus si mal consid´┐Żr´┐Żs par leurs semblables s´┐Żdentaires, coupables de tous les larcins ? Et s'il ne s'agissait apr´┐Żs tout que de parler de l'errance, d'une qu´┐Żte, jamais finie, celle de la conscience ? Evidemment sur ce mode, le champ est large des versions qui restent ´┐Ż ´┐Żcrire : M´┐Żd´┐Że juive, ou sid´┐Żenne. Les griefs restant au fil du temps les m´┐Żmes contre les parias, anciens et nouveaux, que ceux dont furent victimes les magiciennes devenues pour l'occasion sorci´┐Żres. Et la soci´┐Żt´┐Ż civile, semblerait-il, n'a rien envier ´┐Ż l'Inquisition. Quel plus bel exemple quand le but avou´┐Ż est de saisir la permanence du mythe, ce qui, par-del´┐Ż les fronti´┐Żres et le temps, reste inscrit dans l'homme. Des si´┐Żcles d'ombre, et soudain une flamm´┐Żche se fait fulgurance, ´┐Żtoile filante ´┐Żmerge de la masse des t´┐Żn´┐Żbres et s'en va t´┐Żlescoper la myriade de lumi´┐Żre. Une ´┐Żtoile na´┐Żt quand une autre s'´┐Żteint. Errance, la mienne propre aussi, dans les d´┐Żdales de la pens´┐Że, domaine o´┐Ż je suis si peu habile. Ainsi en va-t-il de l'emprise du mythe. Ce qui me relie ´┐Ż ce mythe n'est seulement tangible dans les th´┐Żmes : la connaissance, le sacrifice, mais aussi dans le mouvement qui m'anime. Au-del´┐Ż de ce qui est rationnellement transmissible, l'itin´┐Żraire, le mien, celui du travail accompli, les ´┐Żcueils, dans la confrontation avec la rigueur, avec la m´┐Żthode´┐Ż
Ma d´┐Żmarche se veut anthropologique, mon terrain d'observation tout d'abord le couple, et plus largement l'institution, la soci´┐Żt´┐Ż vues sous l'angle de la relation homme/femme. Ma recherche se limite aux cultures o´┐Ż le mythe resurgit, ´┐Ż diff´┐Żrentes ´┐Żpoques du Ve si´┐Żcle avant J´┐Żsus-Christ ´┐Ż nos jours. Au tout premier plan, le lien qu'entretiennent sur ces terrains id´┐Żologie et morale´┐Ż´┐Ż ´┐Żthique du couple, et par rapport aux enfants ´┐Ż ´┐Żducation et relation. D´┐Żmarche difficile parce que je suis loin d'´┐Żtre moi-m´┐Żme ´┐Ż l'abri des d´┐Żrapages id´┐Żologiques. Qui n'a pas un jour donn´┐Ż comme v´┐Żrit´┐Ż premi´┐Żre ce qui se r´┐Żv´┐Żle un simple jugement moral ? Mon point de d´┐Żpart : une d´┐Żmarche personnelle, ´┐Żgo´┐Żste de connaissance de moi. A l'arriv´┐Że, un besoin de transmettre, non pas des conclusions, car je suis bien ´┐Żloign´┐Że de pouvoir en tirer, mais seulement les ´┐Żtapes de mon cheminement, de mon exp´┐Żrience. Besoin de transmettre, comme un devoir moral, n´┐Ż de discussions avec des femmes, des hommes, des couples, d'´┐Żchanges sur les probl´┐Żmes de couple, de relation avec les enfants, o´┐Ż revient le leitmotiv : ´┐Ż on se laisse bouffer par les enfants, il ne me laisse pas tranquille ´┐Ż ... ´┐Ż´┐ŻCr´┐Żativit´┐Ż, sexualit´┐Ż : c'est pas le pied´┐Ż!´┐Ż´┐Ż Probl´┐Żmes du quotidien qui ´┐Żcrase ? Quel rapport avec M´┐Żd´┐Że ? Autre difficult´┐Ż justement : le mythe ne se manifeste pas forc´┐Żment d'une mani´┐Żre imm´┐Żdiatement intelligible, ´┐Ż laquelle s'ajoute que je ne travaille pas sur le passage ´┐Ż l'acte : l'infanticide r´┐Żel n'est pas mon sujet. Je ne parle que du sacrifice. Quel sacrifice est pour la femme ´┐Ż la base de son acc´┐Żs ´┐Ż une conscience sp´┐Żcifique du f´┐Żminin ? Et il faudra bien parler du f´┐Żminisme, de ses heurs, et mal heurs. F´┐Żminisme d´┐Żclencheur, d´┐Żclic, coup de jus, b´┐Żton dans la fourmili´┐Żre, mais aussi radicalisation, dont femmes et hommes ´┐Żprouvent aujourd'hui ´┐Ż leur d´┐Żpend les cons´┐Żquences. Quid de la femme-femme ? La p´┐Żd´┐Żg´┐Żre ? Quid des valeurs du f´┐Żminin ? Quid de la maternit´┐Ż ? Quid des forces de la r´┐Żaction, des retours progressifs sur les lois contre l'avortement. L´┐Ż pointe le moralisme : je serai tent´┐Że de dire, de pr´┐Żcher : mes s´┐Żurs, il est temps de faire machine arri´┐Żre, de reconna´┐Żtre nos erreurs, nos errements. Voyez comme nous sommes, travailleuses, m´┐Żres, ´┐Żpouses, accabl´┐Żes par la t´┐Żche, les difficult´┐Żs o´┐Ż nous nous sommes mises de suivre les pionni´┐Żres, les amazones. Etre femme aujourd'hui, qu'est-ce que c'est ? Et quelle femme suis-je ?
Catherine Barb´┐Ż, le 12/04/1993
[1] ´┐Ż Le complexe est constitu´┐Ż, pour Jung, de toute perturbation qui barre la libert´┐Ż de la conscience (Les d´┐Żmons du M. A. par ex.).
Il existe trois niveaux de complexes : [2] ´┐Ż In Racines de la Conscience, p.89 ´┐Ż 98. [3] ´┐Ż In M´┐Żtamorphoses de l'´┐Żme et ses symboles. | ||
Envoyez vos commentaires et vos questions au r´┐Żgisseur du site. Copyright ´┐Ż ´┐Ż 1997 Lierre & Coudrier ´┐Żditeur |