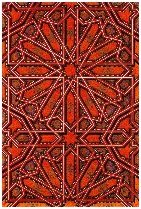|
| ||
|
Le mythe du naturel
| ||
|
| ||
|
Parmi les mythes modernes qui hantent les soci´┐Żt´┐Żs industrialis´┐Żes, il en est qui a pris lentement de l´┐Żampleur, il s´┐Żagit du recours au naturel, dans l´┐Żalimentation mais ´┐Żgalement dans tous les domaines de la vie sociale et domestique´┐Ż Ph´┐Żnom´┐Żne isol´┐Ż il y a trente ou quarante ans, c´┐Żest maintenant une affaire industrielle. La publicit´┐Ż recourt volontiers ´┐Ż ce slogan pour vendre un produit ou une marque. On pourrait penser qu´┐Żil s´┐Żagit d´┐Żune ´┐Ż´┐Żtendance´┐Ż´┐Ż parfaitement louable qui tend ´┐Ż s´┐Żopposer ´┐Ż l´┐Żartificialit´┐Ż de nos soci´┐Żt´┐Żs. Est-ce bien vrai´┐Ż? Ne s´┐Żagit-il pas aussi d´┐Żune volont´┐Ż masqu´┐Że de se prot´┐Żger des ´┐Ż´┐Żm´┐Żfaits´┐Ż´┐Ż de la soci´┐Żt´┐Ż, v´┐Żcue de plus en plus comme inhumaine et impitoyable´┐Ż? N´┐Ży a-t-il pas d´┐Żautres ressorts ´┐Ż ce mouvement´┐Ż? Nous sommes l´┐Ż au confluent de nombreux r´┐Żseaux d'id´┐Żes et de pratiques. Les m´┐Żdecines douces, les aliments naturels existent depuis l'av´┐Żnement de l'industrialisation et du ph´┐Żnom´┐Żne d'urbanisation syst´┐Żmatique qui atteint maintenant la plan´┐Żte enti´┐Żre. Dans les boutiques di´┐Żt´┐Żtiques se croisent maintenant deux client´┐Żles : celle qui appartient ´┐Ż une vieille bourgeoisie issue de la soci´┐Żt´┐Ż industrielle, une client´┐Żle plus moderne, ´┐Ż´┐Żbranch´┐Że´┐Ż´┐Ż. Il y a dix ans, aucun grand distributeur n´┐Żoffrait de produits di´┐Żt´┐Żtiques dans ses magasins. D´┐Żsormais les rayons consacr´┐Żs au naturel ont tendance ´┐Ż s´┐Żallonger. Les produits se sont diversifi´┐Żs, cela va de l´┐Żalimentaire aux m´┐Żdicaments en passant par les produits de beaut´┐Ż Le naturel envahit l´┐Żensemble de la sph´┐Żre quotidienne et pas seulement sur le plan alimentaire. Le fameux ´┐Ż´┐Żjogging´┐Ż´┐Ż, exercice rituel sens´┐Ż pr´┐Żserver notre bonne forme fut un de ces premiers rituels ´┐Ż nous envahir. Tous les discours sur le recours au naturel ont des points communs. Il y est question de sauver le corps et l'´┐Żme par des exercices rituels appropri´┐Żs qui sont d'ordre alimentaire, respiratoire, mais aussi sexuel et gymnique. La finalit´┐Ż est de sauvegarder la puret´┐Ż et la sant´┐Ż ´┐Ż´┐Żd´┐Żorigine´┐Ż´┐Ż. Celle de l´┐Żenfance´┐Ż? Pas s´┐Żr´┐Ż! Peut-´┐Żtre bien qu´┐Żil s´┐Żagirait d´┐Żun ´┐Żtat d´┐Żavant l´┐Żhumanit´┐Ż, une sorte de paradis o´┐Ż la sant´┐Ż serait ´┐Żternelle. Et si la publicit´┐Ż ou les discours moderniste ´┐Żvitent le recours ´┐Ż des id´┐Żes de type religieux, les images sugg´┐Żr´┐Żes ´┐Żvoquent in´┐Żvitablement des id´┐Żologies que la plupart des religions ont d´┐Żj´┐Ż v´┐Żhicul´┐Żes. S´┐Żil s´┐Żagit d´┐Żun produit laitier, par exemple, on ´┐Żvoquera un enfant et une vache parfaitement complices, le tout ´┐Żvoluant dans une nature radieuse aux couleurs de vieux cat´┐Żchisme. Ailleurs, c´┐Żest un ours qui viendra l´┐Żcher le visage de son bienfaiteur, un jeune homme qui sait vivre en alliance avec la nature. Le but vis´┐Ż est bien de ´┐Ż´┐Żsauver´┐Ż´┐Ż quelque chose qui aurait ´┐Żt´┐Ż alt´┐Żr´┐Ż, souill´┐Ż Les images utilis´┐Żes, la paix avec la nature. Le but de ces rites propitiatoires[1] est de d´┐Żbarrasser le corps des souillures de la civilisation. Pour cela, il convient de choisir des aliments indemnes de toute pollution industrielle en empruntant des circuits commerciaux garantissant les qualit´┐Żs requises. Si nous sacrifions des b´┐Żtes pour notre alimentation, il faut qu'elles soient exemptes de tout souillure chimique, antibiotique ou virale. On r´┐Żinvente le ´┐Ż´┐Żhallal´┐Ż´┐Ż[2]. Il y a de la passion dans cette volont´┐Ż actuelle de purification ou de d´┐Żpollution, c´┐Żest selon. L´┐Ż´┐Żpisode dramatique de la maladie de la vache folle, celui de la fi´┐Żvre aphteuse l´┐Ża assez d´┐Żmontr´┐Ż. Des nations enti´┐Żres mobilis´┐Żes pour ´┐Żradiquer un mal dont on ne sait pas vraiment s´┐Żil fera dix victimes ou bien dix mille. Quant ´┐Ż la fi´┐Żvre aphteuse, elle est inoffensive. La science et ses pr´┐Żtres experts perd la boussole et c´┐Żest la rumeur qui s´┐Żamplifie, laquelle se nourrit alors de contenus archa´┐Żques. Les b´┐Żchers, les fum´┐Żes acres ´┐Żveillent de lointains souvenirs qu´┐Żon croyait ´┐Ż jamais effac´┐Żs´┐Ż Avant que ces rites modernes ne contaminent des nations enti´┐Żres, les adeptes du Nouvel ´┐Żge avaient d´┐Żj´┐Ż exp´┐Żriment´┐Ż ce qui est d´┐Żsormais pour nous si familier. Dans les ann´┐Żes 70 ce mouvement ´┐Ż plus tard appel´┐Ż, mouvement du Troisi´┐Żme Mill´┐Żnaire ´┐Ż pr´┐Żfigura nombres de transformations morales qui nous paraissent maintenant banales. La volont´┐Ż de purification de l´┐Ż´┐Żme et du corps date de ces ann´┐Żes. Et ces mouvements ´┐Żtaient si bien inscrit dans une culture de la purification qu´┐Żils nous apportent d´┐Żautres ´┐Żl´┐Żments d´┐Żinformation que ne nous donne pas l´┐Żanalyse des comportements contemporains. En effet, la vie de l'adepte du troisi´┐Żme mill´┐Żnaire faisait une large part ´┐Ż des exercices spirituels pour renforcer la puret´┐Ż de sa relation ´┐Ż la M´┐Żre Nature. M´┐Żditations diverses, massages, exercices tao´┐Żstes ou chamaniques, tantrisme pour les plus jeunes. Autant de possibilit´┐Żs offertes ´┐Ż l'initi´┐Ż pour entrer en communion avec la d´┐Żesse Terre. Ces gestes traduisaient une ferveur tout ´┐Ż fait ´┐Żtonnante chez de jeunes personnes. Depuis, la ferveur a fait place ´┐Ż l´┐Ż´┐Żgo´┐Żsme et ´┐Ż l´┐Żindividualisme forcen´┐Ż d´┐Żune soci´┐Żt´┐Ż h´┐Żdoniste. Et les rites spiritualistes du Nouvel ´┐Żge ont envahi le monde sous une forme certes moins folklorique, plus banalis´┐Że. Mais la finalit´┐Ż diff´┐Żre-t-elle´┐Ż? Qui consisterait ´┐Ż renouer de mani´┐Żre plus ou moins consciente avec des croyances naturalistes de renouveau de l´┐Żalliance avec la Nature m´┐Żre. Cela est ´┐Żtrange car nous pouvons dire qu´┐Żune minorit´┐Ż d´┐Żindividus, r´┐Żunis par un m´┐Żme id´┐Żal a anticip´┐Ż les changements d´┐Żune soci´┐Żt´┐Ż. Cela s´┐Ż´┐Żtait d´┐Żj´┐Ż produit dans le pass´┐Ż. Ainsi le mouvement romantique allemand pr´┐Żfigure largement l´┐Żapparition du Surr´┐Żalisme. Mais c´┐Żest une autre affaire´┐Ż! Le Nouvel Age pr´┐Żfigurait-il un retour ´┐Ż une mystique de la Nature´┐Ż? Chez le jeune adepte de la religion naturelle du Troisi´┐Żme Mill´┐Żnaire, l'acte banal se nourrit d'abord d'une id´┐Żologie et il s'agit autant de sauver son corps et sa plan´┐Żte que de purifier son ´┐Żme. Cette splendide ferveur trouve son origine dans la vieille illusion romantique du retour ´┐Ż la Nature mais elle rejoint aussi les fondements de toute forme d´┐Żanimisme. Pourtant ce n´┐Żest qu´┐Żune illusion aveugle car la Terre est pollu´┐Że jusqu'au fond de la for´┐Żt la plus sombre, jusque dans les d´┐Żserts les plus hostiles. Cela est un fait incontournable et ind´┐Żniable que nous ne pouvons affronter par la seule force de bonnes intentions. Car si nos savants ont d´┐Żcid´┐Ż de s'enivrer, il n'y a´┐Ż aucune raison que la situation change. Quand nos savants ´┐Żtaient raisonnables et prudents, d´┐Żj´┐Ż les arbres mouraient, que sera-ce dans leur ivresse ?[3] Ce recours aux id´┐Żologies du Nouvel Age, traduisait-il la nostalgie et le d´┐Żsespoir d'une jeunesse qui refusait d´┐Żj´┐Ż le n´┐Żant du conformisme, le nivellement du raz de mar´┐Że lib´┐Żral en voulant s'en abstraire´┐Ż? Si on lit les magazines, les revues scientifiques de cette ´┐Żpoque ´┐Ż ann´┐Żes 70 ´┐Ż on retrouve les m´┐Żmes questions que nos experts s´┐Żarrachent actuellement devant les t´┐Żl´┐Żvisions et auxquelles ils r´┐Żpondent par les m´┐Żmes certitudes fanfaronnes. Pourtant, il ne fait aucun doute qu'y transparaissent ´┐Żgalement les traits encore grossiers des id´┐Żologies du futur. Avec leur mani´┐Żre de traverser les acad´┐Żmismes et de rejoindre d'autres paroles ´┐Ż celles des penseurs arabes, africains ou sud-am´┐Żricains ´┐Ż, ces id´┐Żes acqui´┐Żrent une force qui va au-del´┐Ż de la place qu'on leur accorde. Les cultures occidentales du nord sont fond´┐Żes sur le monoth´┐Żisme et la notion d´┐ŻUnit´┐Ż comme fusion dans un grand tout. Cela a forg´┐Ż les mentalit´┐Żs jusque dans les activit´┐Żs quotidiennes les plus banales. Nous recherchons Le produit id´┐Żal, si ce n´┐Żest le/la compagnon/compagne id´┐Żal/e pour partager notre vie. Les h´┐Żros modernes demeurent, un temps certes tr´┐Żs ´┐Żph´┐Żm´┐Żre, ´┐Ż´┐ŻLe h´┐Żros du si´┐Żcle´┐Ż´┐Ż. Et comme, une seule exp´┐Żrience ne suffit pas ´┐Ż embrasser la totalit´┐Ż du monde, nous recommen´┐Żons inlassablement, en qu´┐Żte d´┐Żun prochain unique et d´┐Żfinitif´┐Ż parfois dans une lutte f´┐Żroce. Les peuples plus proches du polyth´┐Żisme et donc habitu´┐Żs ´┐Ż consid´┐Żrer la Nature et l´┐Żunivers sous des aspects multiples pourront plus facilement faire face ´┐Ż la diversification des activit´┐Żs humaines d´┐Żsormais inscrites dans une globalisation qui aplanira de plus en plus les particularismes. Le respect de la diff´┐Żrence ne pourra vraiment se concevoir que dans l´┐Żabandon de notre vision unitaire du monde et de la vie.[4] ConclusionOn ne peut nier qu´┐Żil existe une ambigu´┐Żt´┐Ż certaine dans le recours f´┐Żroce au naturel. D´┐Żune part, il existe actuellement un mouvement de ralentissement ou de freinage de l´┐Żenvahissement par les produits exclusivement artificiels ´┐Ż quoiqu´┐Żil faille s´┐Żinterroger sur ce terme ´┐Ż et il s´┐Żagit d´┐Żune volont´┐Ż d´┐Żlib´┐Żr´┐Że de diversification des mati´┐Żres premi´┐Żres qui entra´┐Żne fatalement une ´┐Żvolution des modes de production. Il s´┐Żagit aussi du r´┐Żsultat d´┐Żune prise de conscience globale que le ´┐Ż´┐Żtout artificiel´┐Ż´┐Ż correspondait ´┐Ż une utopie. Mais, nous ne pouvons nier que notre volont´┐Ż de recourir ´┐Ż des produits absolument naturels renvoie ´┐Ż une crainte qui ne se dit pas, la peur inavou´┐Że des pollutions par ce qui nous reste de naturel, notre corps. Et, ´┐Ż lui donner du naturel comme aliment, comme huile solaire ou comme v´┐Żtement nous esp´┐Żrons le d´┐Żbarrasser de ses attributs sauvages. L´┐Żambigu´┐Żt´┐Ż est donc double´┐Ż: c´┐Żest la crainte de la part animale de notre corps qui nous pousse ´┐Ż le saturer de naturel. Ce qui voudrait dire que nous souhaitons que les fabricants de toutes sortes nous produisent des objets ou des aliments ´┐Ż base de produits naturels. Nous voudrions, en quelque sorte, qu´┐Żils mobilisent toute leur technologie pour changer la composition des produits. Dans le m´┐Żme temps, nous allons aux limites de l´┐Żabsurde, faire de notre corps un objet assujetti ´┐Ż notre volont´┐Ż. Dans le m´┐Żme temps, nous justifions ce besoin en ´┐Ż´┐Żnaturel´┐Ż´┐Ż par un refus de l´┐Żartificialit´┐Ż de la technologie, en invoquant les abus que celle-ci g´┐Żn´┐Żre. Nous ne voulons pas de l´┐Żinhumanit´┐Ż des sciences et des techniques sauf si elles nous prot´┐Żgent de nos d´┐Żmons. La nature a perdu ses monstres et ce sont d´┐Żsormais deux espaces que les d´┐Żmons menacent, notre corps mati´┐Żre et notre espace psychique int´┐Żrieur. Il n´┐Żest qu´┐Ż´┐Ż voir les obsessions qui s´┐Żexposent dans les sc´┐Żnarios de films´┐Ż: la d´┐Żvastation provoqu´┐Ż par des virus indomptables ou bien la submersion de notre conscience par la folie. Comme ce fut le cas pour H´┐Żrakl´┐Żs. Mais nous ne sommes pas des h´┐Żros´┐Ż! ´┐Ż moins que ´┐Ż [1] ´┐Ż Qui rend la divinit´┐Ż favorable et, par extension tout acte qui rend le fid´┐Żle pur pour acc´┐Żder ´┐Ż la divinit´┐Ż. [2] ´┐Ż L´┐Ż´┐Żquivalent musulman du Kacher. [3] ´┐Ż On pourra noter que dans le monde contemporain, les hommes de sciences nous projettent vers des horizons fantastiques qui tendent ´┐Ż montrer une science invincible et conqu´┐Żrante. Rien n'est pire que cette ivresse factice et g´┐Żn´┐Żratrice d'´┐Żcran ´┐Ż une r´┐Żalit´┐Ż bien plus triviale. [4] ´┐Ż Il en va de m´┐Żme pour le r´┐Żglement de probl´┐Żmes aussi importants que le respect des particularismes r´┐Żgionaux dans une Europe en construction. Si nous n´┐Żabandonnons pas notre vision unitaire au profit d´┐Żune repr´┐Żsentation diff´┐Żrenci´┐Że du monde en la traduisant en termes politico-juridiques, l´┐ŻEurope demeurera un enfan´┐Żon.
Illel Kieser, le 12/06/2001
| ||
Envoyez vos commentaires et vos questions au r´┐Żgisseur du site. Copyright ´┐Ż ´┐Ż 1997 Lierre & Coudrier ´┐Żditeur |