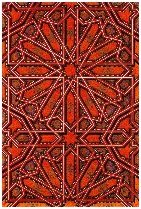|
| ||
|
Le mythe, la raison et nous
| ||
|
| ||
|
Entre la science et le mythe, il y a toujours eu des malentendus. Comme chemin du savoir la science tend ´┐Ż ignorer ce qui est mythique ´┐Ż muet ´┐Ż. Cependant les recherches arch´┐Żologiques et historiques on souvent donner consistance au moins partiellement ´┐Ż ce que rapportent les mythes et les l´┐Żgendes. D´┐Żs lors la science peut coloniser le mythe, lui faisant subir les triturations exp´┐Żrimentales qui lui semblent opportunes. Il n´┐Żest ´┐Żvidemment pas question que le mythe, comme mod´┐Żle d´┐Żexpression de l´┐Żimaginaire, devienne autonome, qu´┐Żil pr´┐Żtende avoir une vie propre. Il est encore plus aberrant d´┐Żaffirmer que le mythe pourrait repr´┐Żsenter le mouvement d´┐Żune culture ´┐Ż travers l´┐ŻHistoire et en diff´┐Żrents territoires´┐Ż ´┐Ż Les th´┐Żses contemporaines qui critiquent les productions de l´┐Żimaginaire, dont le mythe, sont parfaitement pr´┐Żsent´┐Żes par Henri Atlan dans son essai ´┐Żpist´┐Żmologique : Intercritique de la Science et du Mythe (Ed. du Seuil, 1986). Atlan d´┐Żnonce fort ´┐Ż propos les diff´┐Żrentes impostures qui auraient la pr´┐Żtention de se pr´┐Żsenter comme des recours modernes. Son rep´┐Żrage des diff´┐Żrents courants de pens´┐Że est pr´┐Żcis, exhaustif ´┐Ż autant que la chose soit possible actuellement ´┐Ż et sa d´┐Żmonstration fait preuve d'une nettet´┐Ż rare pour une ´┐Żuvre d'´┐Żpist´┐Żmologie. En outre, le prestige de l'auteur apporte un surcro´┐Żt de sagesse ´┐Ż un travail tr´┐Żs vaste. Pourtant, si l'auteur int´┐Żgre parfai´┐Żtement le discours psychanalytique freudien, il se livre ´┐Ż une critique fort habile des th´┐Żses jungiennes et des travaux des continuateurs de Jung, notamment ceux de Pierre Soli´┐Ż. C'est, semble-t-il, le meilleur ouvrage de critique de l´┐Ż´┐Żuvre de Jung qui ait ´┐Żt´┐Ż ´┐Żcrit jusque-l´┐Ż et qui apporte au freudisme une caution scientifique que nous avions cru perdue. La th´┐Żse d'Henri Atlan est claire, quoique s´┐Żduisante et partielle malgr´┐Ż les garanties du contraire. Intercritique de la Science et du Mythe ? Il e´┐Żt mieux valu annoncer qu'il s'agissait du fondement du Mythe selon l'auteur, ou le recours supr´┐Żme de la Science. Il expose des vues tout ´┐Ż fait partisanes et r´┐Żductrices sur le mythe, n'en r´┐Żcup´┐Żrant que ce qui para´┐Żt accessible au regard de la science. Le reste, rejet´┐Ż dans les oubliettes de la fabulation ou de la mystification, est class´┐Ż comme sp´┐Żculation. Il est clair que l'imaginaire de soci´┐Żt´┐Ż doit ´┐Żtre assujetti ´┐Ż la science. N´┐Żanmoins, ses th´┐Żses restent un support de r´┐Żflexion et une exhortation ´┐Ż la prudence. Ses rappels des textes bibliques servent parfois de support ´┐Ż la glose et donnent une vague impres´┐Żsion d´┐Ż´┐Żcum´┐Żnisme. Mais cela fait partie des modes de la litt´┐Żrature scientifique. Ainsi, (p.351-352), ´┐Ż´┐Żla v´┐Żrit´┐Ż poussera de terre´┐Ż´┐Ż et, si nous suivons bien, la paix aussi. C'est l´┐Ż un rappel heureux, l'homme devant accepter que sa recherche de v´┐Żrit´┐Ż passe par l'exploration du sol avec ce que la m´┐Żtaphore peut laisser peser comme sens. La v´┐Żrit´┐Ż ne tombe pas du ciel mais se d´┐Żcouvre et se d´┐Żvoile progressivement au regard de celui qui veut bien la chercher. L'auteur s'appliquera tout au long de ces pages ´┐Ż nous composer une sorte de po´┐Żme mystique d´┐Żdi´┐Ż ´┐Ż la V´┐Żrit´┐Ż, mais, en m´┐Żme temps, il cherche par tous les moyens ´┐Ż att´┐Żnuer la partie po´┐Żtique de son propos comme s'il sentait bien le pouvoir de s´┐Żduction et de fascination de la nudit´┐Ż de la Sophia. La t´┐Żte peut-elle rester froide ? Le regard qui se porte sur la Sagesse ´┐Żternelle la laisse inchang´┐Że, immuable et fixe comme la vierge surgie du sol, s'´┐Żl´┐Żve vers le ciel dans son assomption divine. Et Atlan finit, ´┐Ż son insu, par aller ´┐Ż l'encontre de sa propre d´┐Żmonstration : il r´┐Żv´┐Żle un emporte´┐Żment mystique alors qu'il propose de passer toute forme de syst´┐Żme au crible de la science. Atlan met une forme de science en critique, essayant de r´┐Żconcilier les valeurs fondamentales issues de la Torah avec la psychanalyse. L´┐Ż´┐Żuvre reste au plan de la logique formelle, la po´┐Żsie ´┐Żtant contenue dans des arri´┐Żre-plans que le discours ignore. Car dans la po´┐Żsie s'exprime parfois l'emphase religieuse et le fait religieux est psycholo´┐Żgique or si le religieux veut embrasser l'universel, le psychologique se veut et se croit souvent au-del´┐Ż du religieux. Au prix bien souvent de pures sp´┐Żculations vides de sens, sans autre int´┐Żr´┐Żt qu'au plan de la logique (quand cela r´┐Żussit ´┐Ż soutenir la rigueur d'un raisonnement logique). Henri Atlan analyse ainsi un certain nombre de syst´┐Żmes r´┐Żput´┐Żs coh´┐Żrents. Au terme de tous ces d´┐Żtours surgit la Science, toujours la m´┐Żme. On arrive alors ´┐Ż croire que Tout est explicable et on atteint le but inverse qu'on s'´┐Żtait fix´┐Ż. A vouloir vitaliser la psychologie en la hissant hors des dogmatismes d'´┐Żcole et des ´┐Żchafaudages intellectuels, on finit par pr´┐Żtendre expliquer jusqu'au myst´┐Żre de l'´┐Żtre. Tout s'explique, chacun y met de sa science, m´┐Żme les astrophysiciens ; alors le myst´┐Żrieux frappe l´┐Ż o´┐Ż notre raison est vici´┐Że, l´┐Ż o´┐Ż r´┐Żside l'ombre de nos pr´┐Żvoyances, de nos s´┐Żcurit´┐Żs et de nos certitudes. Ce n'est pas tant l'explication sur toute chose qui peut g´┐Żner, c'est bien plut´┐Żt de laisser croire la disparition de toute forme de myst´┐Żre qui constitue une imposture. Les scientifiques ne veulent absolument pas se rendre compte qu'une telle vis´┐Że est pr´┐Żcis´┐Żment celle de toute religion : r´┐Żpondre aux grands myst´┐Żres de l'´┐Żtre. Le XXe si´┐Żcle offre un spectacle "charmant" si l'on compare les th´┐Żories scientifiques et les dogmes religieux. Tous les discours cohabitent, des plus archa´┐Żques aux plus avanc´┐Żs. Le sauvage, primitif et rude sous son habit de citoyen, c´┐Żtoie les germes du futur, dispers´┐Żs chez quelques individus qui, tr´┐Żs souvent, ignorent eux-m´┐Żmes qu'ils en sont porteurs. Comment concilier tous ces discours puisqu'ils se nient les uns les autres et que cette n´┐Żgation garantit la s´┐Żcurit´┐Ż de chacun ? Science et religion sont ´┐Ż pr´┐Żsent aussi ´┐Żtrang´┐Żres l'une ´┐Ż l'autre qu'un iceberg le serait ´┐Ż un champs d'oliviers. Mais cette ´┐Ż´┐Żchose´┐Ż´┐Ż myst´┐Żrieuse qui sait si bien exploiter les techniques de l'Homo Sapiens n'a de cesse d'englober et de rationaliser tous les myst´┐Żres, fondant chaque jour de nouvelles g´┐Żn´┐Żrations de dogmes et de certitudes qui durent le temps des roses sans en avoir ni les charmes ni les parfums. La V´┐Żrit´┐Ż, comme une ma´┐Żtresse offens´┐Że, semble se d´┐Żtourner de son ancien amant que l'angoisse alors ´┐Żtreint. L'Homme blanc a perdu sa religion et sa science fait p´┐Żle figure devant l'univers. La ReligionD'aucuns pr´┐Żnent le retour du religieux pour r´┐Żenchanter le monde. L'unanimit´┐Ż des penseurs se fait l´┐Ż-dessus. Mais, nombreuses sont les postulantes en comp´┐Żtition pour combler ce besoin de cercler le chaos de notre culture. Comme si le pourvoi contre l'angoisse du monde constituait une t´┐Żche prestigieuse. Cela s'av´┐Żre comme un ch´┐Żur, une rumeur dont le contenu trahit un discours qui s'aveugle lui-m´┐Żme, g´┐Żmit sur la perte de l'´┐Żmotion mystique alors qu'il en participe, geint devant l'immensit´┐Ż de la t´┐Żche alors m´┐Żme que la mise en ´┐Żuvre se fait (sans lui). Car l'Occidental oublie souvent son ethnocentrisme et les pr´┐Żtentions universalistes de sa pens´┐Że. C'est d'abord de cela dont il sera question s'il s'agit de refleurir notre petit paradis intellectuel, de regreffer les fruitiers d´┐Żsormais st´┐Żriles de nos universit´┐Żs. La pens´┐Że occidentale ne cr´┐Żve-t-elle pas de l'espoir insens´┐Ż de se suffire encore ´┐Ż elle-m´┐Żme ?[1] Tout serait simple s'il ne s'agissait encore d'une affaire de famille, comme sous la Terreur. Mais si l'´┐Żtre Supr´┐Żme a rat´┐Ż son entr´┐Że, la notion m´┐Żme de Totalit´┐Ż trouve un terrain propice dans tous les domaines de la vie de l'Homme (plan´┐Żtaire celui-l´┐Ż). En moins de dix ans, gr´┐Żce aux techniques modernes de communication, n´┐Żimporte quel fait culturel important, m´┐Żme ´┐Ż´┐Ż´┐Żconomique´┐Ż´┐Ż, a fait le tour du monde. C'en est d´┐Żsormais fini des affaires qui se r´┐Żglent au fond des officines. Les bannis r´┐Żclament leur d´┐Ż aux portes du palais. La dette est ancienne et date de la conquista. Souvenez-vous, l'Europe sortait du Moyen ´┐Żge. Les rivi´┐Żres d'or de la conqu´┐Żte coulaient, accueillantes et fra´┐Żches aux pieds de l'Homme blanc ma´┐Żtre de la Nature gr´┐Żce aux outils que sa science lui donnait. A cette ´┐Żpoque, on d´┐Żportait des esclaves, il y en eut plusieurs millions. L'Afrique en g´┐Żmit encore ! On massacrait les Indiens au Sud, au Nord. L'Homme blanc ´┐Żructa ´┐Ż la face des Dieux et se fit une place gigantesque sur la plan´┐Żte. Ce fut autant une conqu´┐Żte ´┐Żconomique qu'une affaire religieuse et nous voudrions alors revenir aux vieilles recettes pour oublier (ou faire oublier) les exc´┐Żs de l'imp´┐Żrialisme occidental qui s'est perp´┐Żtu´┐Ż en pens´┐Żes, en paroles et en actions. Rien ne peut effacer la m´┐Żmoire de la terre. Ce recours au religieux, je l'ai soulign´┐Ż plus haut, constituerait une gigantesque r´┐Żgression qui serait peut-´┐Żtre l'aboutissement ultime de la longue marche r´┐Żtrograde de l'humanit´┐Ż dont Nietzsche parlait. Pouvons-nous faire l'´┐Żconomie du passage au chaos n´┐Żcessaire pour un remodelage plan´┐Żtaire ? Reformulation qui se traduira au plan ´┐Żconomique, politique, culturel et moral. Plut´┐Żt que d'affronter ce passage, finalement naturellement hivernal, nous pr´┐Żf´┐Żrons pr´┐Żserver des acquis en conservant les pouvoirs qui nous restent mais dont nous savons qu'ils n'encadrent plus la r´┐Żalit´┐Ż. Tout converge ´┐Ż laisser penser que nous changeons de Dieu ou de Totem, que la plan´┐Żte conna´┐Żt une r´┐Żvolution probablement ´┐Żgale ´┐Ż celle de Copernic, qu'un nouvel arch´┐Żtype se constelle, qu'un messie est en passe de s'incarner, qu'un mahdi[2] se r´┐Żv´┐Żle... Nous sommes en d´┐Żbut de si´┐Żcle et de mill´┐Żnaire. Toutes les terreurs se conjuguent. Mais, d´┐Żj´┐Ż, d'autres se pr´┐Żparent. La n´┐Żognose et l'astrologieJ'ai bri´┐Żvement fait r´┐Żf´┐Żrence plus haut aux nombreux mouvements du Nouvel ´┐Żge. Que l'aggiornamento l'accepte ou non ces courants contemporains appartiennent ´┐Ż notre quotidien. Leur pr´┐Żsence devient aussi incontournable que la port´┐Że de leurs id´┐Żaux. Roland Cahen, disciple de Jung et traducteur de ses ´┐Żuvres en langue fran´┐Żaise, rel´┐Żve que la psychanalyse ne fait plus recette et s'interroge sur les raisons de cette d´┐Żsaffection15 Ce qui vide ceci remplit cela. Or, la plupart des ´┐Ż´┐Żth´┐Żories´┐Ż´┐Ż du Nouvel ´┐Żge s'engouffrent dans les vides des espaces conceptuels de la psychologie acad´┐Żmique et se pr´┐Żsentent comme les r´┐Żactions au r´┐Żductionnisme des syst´┐Żmes plus m´┐Żdicalis´┐Żs. Beaucoup se recommandent de l'´┐Ż´┐Żid´┐Żal jungien´┐Ż´┐Ż tout en gardant une grande libert´┐Ż par rapport aux contenus cliniques de la psychologie des profondeurs. Il s'y d´┐Żveloppe un regard critique sur la psychanalyse m´┐Żme si de nombreux emprunts sont faits ´┐Ż cette discipline. Ces courants veulent mettre en valeur ce qui est sup´┐Żrieur dans la nature humaine : la libert´┐Ż, la cr´┐Żativit´┐Ż, la spiritualit´┐Ż. Ils est souvent fait r´┐Żf´┐Żrence ´┐Ż la dimension humaine prise dans sa totalit´┐Ż galactique ainsi qu'´┐Ż des notions rest´┐Żes ´┐Żtrang´┐Żres ´┐Ż la docte psychologie : astrologie, kabbale, ´┐Żl´┐Żments de gnose, doctrines ´┐Żsot´┐Żriques... On a l'impression de se trouver devant un vaste ´┐Żchafaudage sans coh´┐Żrence aucune et sans autre finalit´┐Ż que le d´┐Żsir de ceux qui en empruntent les voies (qu´┐Żte d'harmonie, paix...). Cependant, le psychologue aurait tort d'exclure aussi vite ces mouvements de la psychologie moderne. Certes, les universit´┐Żs leur sont ferm´┐Żes, mais l'on sait bien que celles-ci r´┐Żcup´┐Żrent bien plus le savoir qu'elles n´┐Żoccupent le champ de la recherche en mati´┐Żre de psychologie. Ces courants, m´┐Żme dans leur exc´┐Żs, nous renseignent sur l'insertion de la psychologie dans le r´┐Żel, exprimant ainsi une tendance de soci´┐Żt´┐Ż qui ´┐Żveille des ´┐Żchos importants dans nos psych´┐Żs profondes. Et il ne sert ´┐Ż rien de dire que cela est d´┐Ż aux modes et qu'il s'agit en fait d'une influence inopportune de la culture dans le champ de la th´┐Żorie. La prise en compte des id´┐Żaux ainsi expos´┐Żs est d'autant plus importante qu'ils furent d´┐Żj´┐Ż exprim´┐Żs par des personnalit´┐Żs aussi vari´┐Żes qu'Arthur Koestler, l'anthropologue fran´┐Żais Marcel Mauss, Koeler et Wertheimer de la Gestalt (cette Gestalt, soit dit en passant, fait actuellement l'objet d'un engouement ´┐Żtonnant). Traiter les aphorismes de ces syst´┐Żmes par le m´┐Żpris, comme le font la plupart des psychanalystes et des psychologues contemporains, rel´┐Żve d'une forme d'obscurantisme. En effet, ces doctrines insistent souvent sur la n´┐Żcessit´┐Ż de restituer ´┐Ż l'humain sa dimension sacr´┐Że et de lui redonner une dignit´┐Ż que les r´┐Żvolutions scientifiques lui ont peu ´┐Ż peu fait perdre. Il ne serait pas sans int´┐Żr´┐Żt de voir ce que ces th´┐Żories doivent aux sources du Marxisme. Nous y retrouvons la trace de la philosophie de Husserl, mais aussi beaucoup de notions ´┐Żpicuriennes, ainsi que ´┐Ż c'est le plus ´┐Żtonnant ´┐Ż certaines identit´┐Żs avec le courant philosophique russe tel que Berdiaev nous l'a r´┐Żv´┐Żl´┐Ż au d´┐Żbut du si´┐Żcle. Ce n'est donc pas tout ´┐Ż fait un hasard si des traits de philosophies asiatiques se rep´┐Żrent dans ces syst´┐Żmes. Le caract´┐Żre brouillon des vocabulaires, la multitude des mouvements, leurs fr´┐Żquentations d´┐Żrangeantes renvoient ´┐Ż l'acad´┐Żmisme psychologique leur caract´┐Żre puritain, dogmatique et maniaque. C'est pourquoi, si j'ai rappel´┐Ż tant de noms, parfois inconnus[3] ce n'est pas pour faire ´┐Żuvre d'´┐Żrudition, mais pour sugg´┐Żrer la formidable puissance d'ingestion de ces courants de pens´┐Że. Il y a dans cette facult´┐Ż un ph´┐Żnom´┐Żne qui m´┐Żrite une certaine attention et je me demande si ces ´┐Ż´┐Żth´┐Żories´┐Ż´┐Ż ne sont pas traver´┐Żs´┐Żes par des intuitions cr´┐Żatrices qui seraient fondatrices d'un nouveau paradigme. La r´┐Żcup´┐Żration si rapide des discours existants ne serait que la manifestation d'une tentative de ces ´┐Ż´┐Żfantaisies´┐Ż´┐Ż pour se frayer un chemin vers la conscience. En Europe ces alternatives pour un nouveau monde se scindent en deux groupes. L'un reste tout ´┐Ż fait ro´┐Żmantique, id´┐Żaliste sans aucun pragmatisme et semble prendre le relais de l'ancien ´┐Żsot´┐Żrisme, l'autre r´┐Żunit des groupes tr´┐Żs actifs et particuli´┐Żrement r´┐Żalistes. La France conna´┐Żt surtout le courant id´┐Żaliste car le second s'accommode mal du conservatisme ambiant. Souvent ces id´┐Żes du Nouvel ´┐Żge font r´┐Żf´┐Żrence ´┐Ż un retour harmonieux de la paix entre les hommes et ´┐Ż la r´┐Żconciliation entre l'Homme et la Nature. Ce th´┐Żme se retrouve dans d'autres milieux mais aussi dans l'histoire des hommes depuis des mill´┐Żnaires. Une telle fixit´┐Ż peut-elle avoir un sens ? Les m´┐Żdecines douces et le mythe du NaturelLa chute de l'enfant divinCrise de culpabilit´┐Ż de l'OccidentLes nombreuses solutions ´┐Ż la crise masquent mal le sursaut d'une conscience h´┐Żg´┐Żmonique attach´┐Że ´┐Ż conserver les lumi´┐Żres rassurantes de ses pouvoirs face ´┐Ż la mont´┐Że d'un chaos qui se trouve ´┐Żtre l'envers d'un ordre devenu d´┐Żsuet. Tout cela se joue dans un d´┐Żcor mill´┐Żnariste, dramatique ´┐Ż souhait, quelque peu fantastique. Les morts s'en reviennent de leur s´┐Żpulture. Leurs faces caverneuses se tournent vers les corps assoupis des vivants, happant leur souffle, leur sang, leur qui´┐Żtude. Les nuits de l'Homme moderne se peuplent d'angoisses terribles. A l'image de ce que Andr´┐Żi Tarkovski a montr´┐Ż dans ses films, les guerres viennent maintenant jusque dans nos r´┐Żves. Et, comme un enfant persuad´┐Ż de la toute-puissance de ses gestes, nous souhaitons r´┐Żparer tout cela : ne suffirait-il pas de d´┐Żboulonner la D´┐Żesse Raison, mise en place en 1789, et de la remplacer par quelque nymphe promue ´┐Ż une nouvelle dignit´┐Ż ? Harmonie convien´┐Żdrait tr´┐Żs bien pour ce r´┐Żle qui l'allierait parfaitement ´┐Ż ses petits fr´┐Żres Nombre et Mesure. Au Comit´┐Ż de Salut Public succ´┐Żderait un Comit´┐Ż National d'´┐Żthique... Et les vieux dogmes rafra´┐Żchis reprendraient du service. Il y a dans l'air que nous respirons des relents m´┐Żphitiques qui tiennent leurs ´┐Ż´┐Żqualit´┐Żs´┐Ż´┐Ż d'autres ´┐Żmanations que celles des hydrocarbures. L'atmosph´┐Żre empeste aussi la culpabilit´┐Ż. La r´┐Żf´┐Żrence ´┐Ż la R´┐Żvolution Fran´┐Żaise marque un contexte : ´┐Ż ce moment-l´┐Ż, l'Homme sort d'une p´┐Żriode au cours de laquelle Dieu avait ´┐Żt´┐Ż un recours. D´┐Żs la fin du XVIIe si´┐Żcle, la vieille cosmogonie s'´┐Żcroule et ´┐Ż´┐Żl'euphorie newtonienne, quand le savant semble pr´┐Żt ´┐Ż tout expliquer par des lois intentionnellement voulues de Dieu, c´┐Żde devant l'irreligion pr´┐Żch´┐Że au nom d'une Nature en r´┐Żvolte contre le Cr´┐Żateur´┐Ż´┐Ż[4]. L'homme est persuad´┐Ż qu'en la technique repose le secret du bonheur : chacun devient alors libre de g´┐Żrer son plaisir, ses int´┐Żr´┐Żts et sa terre mise au rang d'objet. Le th´┐Żme de la libert´┐Ż restera primordial. Il est tout ´┐Ż fait net que ce terme confond dans un m´┐Żme phon´┐Żme des notions tr´┐Żs diverses telles que l'affranchissement de toute tutelle, l'absence totale de contraintes, y compris corporelles´┐Ż; ce qui confond nature et asservissement. Or si la conscience dont parlent les psychologues ne peut se concevoir que chez un ´┐Żtre affranchi, il est ind´┐Żniable que celui-ci int´┐Żgre ´┐Żgalement ses composantes psychiques instinctives en les ´┐Ż´┐Żdomestiquant´┐Ż´┐Ż pour les mettre judicieusement au service de sa libert´┐Ż. Si l'on tient compte de la sagesse de toute exp´┐Żrience humaine, il n'y a pas de v´┐Żritable libert´┐Ż qui ne soit d'abord une alliance entre deux termes d'´┐Żgale puissance. En d'autres termes, l'´┐Żtre libre est celui qui sait r´┐Żsoudre en le sublimant son conflit entre Nature et Culture. Ce point est de toute premi´┐Żre importance si nous voulons comprendre les grands principes de la R´┐Żvolution selon un regard psychologique. Prom´┐Żth´┐Że technicien r´┐Żforme la soci´┐Żt´┐Ż et l'Homme se veut sans tyran, affranchi, libre. D´┐Żsormais, la place est faite ´┐Ż cette r´┐Żvolution qui voudra r´┐Żenchanter le monde. Au nom des id´┐Żaux les plus grandioses, les Montagnards massacrent les Girondins (trop impurs, contamin´┐Żs), la D´┐Żesse Raison d´┐Żtourne le peuple de Notre Dame de Paris pour le conduire vers les places o´┐Ż l'on guillotine. Sacrifices d´┐Żdi´┐Żs ´┐Ż l'´┐Żtre Supr´┐Żme, destin´┐Żs ´┐Ż purifier l'Homme de ses crimes pour lui arracher sa mauvaise conscience. La "Libert´┐Ż Naturelle de tous les hommes" produit le Tribunal R´┐Żvolution´┐Żnaire et la Terreur. La crise de culpabilit´┐Ż qui ´┐Żtreint alors l'Homme ´┐Żclate en de terribles tornades lourdes d´┐Żagressivit´┐Ż et de violence. L'Homme souffre d'une terrible mauvaise conscience d'avoir souill´┐Ż la Natura Mater. Ses justiciers lui donneront un Roi et tant d'autres victimes en sacrifice... Les fant´┐Żmes que Diderot avait entrevus sortent de l'ombre et les barri´┐Żres de la civilisation l´┐Żchent pour laisser passer la horde hurlante des fauves sanguinaires d´┐Żguis´┐Żs en d´┐Żmons justiciers de la Nature. L'Homme moderne a-t-il plus de pond´┐Żration et de sagesse ? D'apr´┐Żs les discours cela ne fait pas de doute. Mais la guerre du S.I.D.A. ´┐Ż celle des laboratoires et des politiques ´┐Ż a montr´┐Ż que la b´┐Żte est toujours l´┐Ż, tapie dans l'ombre, pr´┐Żte ´┐Ż bondir. Alors, l'obscurantisme que certains pr´┐Żdi´┐Żsent, est-ce bien celui des canons ? Est-ce celui que nous pourrons compenser ´┐Ż coup de subventions dans la culture europ´┐Żenne ? Michel Henry s´┐Ż´┐Żcrie : ´┐Ż´┐ŻParce que la culture est l'autod´┐Żveloppement de la vie, elle se trouve exclue de l'espace europ´┐Żen qui d´┐Żfinit la modernitÚá╗[5] . Et pour ce penseur, la barbarie s'installe dans la coupure entre savoir et culture, technique et art. Ce sont l´┐Ż des constats, mais cela annonce-t-il pour autant la venue des barbares´┐Ż? Si nous en croyons les biologistes, la vie rena´┐Żt sous les microscopes, les scalpels et dans les ´┐Żquations des math´┐Żmaticiens. Est-ce la barbarie ou le signe in´┐Żluctable d'un monde qui meurt ? Ne voyons- nous pas l´┐Ż le triste spectacle d'une philosophie qui n'a pas su d´┐Żfinir le mal qui la ronge ? Selon le ma´┐Żtre Hegel, ce mal n'existe pas ! Mais si´┐Ż! s'´┐Żcrient ceux-l´┐Ż m´┐Żme qui en d´┐Żcrivent les effets. Sid´┐Żration des sens, silence, conflit int´┐Żrieur, nous sommes dans l'impasse et nous accusons les m´┐Żdia. Le r´┐Żle des m´┐Żdia´┐Ż´┐ŻLes m´┐Żdia corrompent tout ce qu'ils touchent en pla´┐Żant dans l'inconsistant... l'´┐Żtre de l'Essentiel, ´┐Ż savoir l'accroissement en soi de la vie selon sa temporalit´┐Ż propre´┐Ż´┐Ż[6] La rumeur anti-m´┐Żdia s´┐Żest largement amplifi´┐Ż depuis que ces lignes ont ´┐Żt´┐Ż ´┐Żcrites. Chacun y va de sa rengaine, des politiques aux scientifiques, en passant par les sportifs ou les intellectuels. Pierre Bourdieu s´┐Żest constitu´┐Ż une image de fer de lance dans la d´┐Żnonciation des exc´┐Żs des media. Mais cela ne l´┐Żemp´┐Żche pas de s´┐Żen servir pour cultiver son image de pourfendeur polydirectionnel. C´┐Żest un peu comme si nous donnions un violent coup de pied ´┐Ż notre t´┐Żl´┐Żviseur parce qu´┐Żil nous annonce une mauvaise m´┐Żt´┐Żo ou la chute des actions Alcatel. Les media sont un outil et, selon toute vraisemblance, nous ne savons pas nous en servir, pas m´┐Żme les journalistes d´┐Żailleurs´┐Ż Et si nous faisons de tels proc´┐Żs aux m´┐Żdia, c'est bien parce que quelque chose se r´┐Żv´┐Żle ´┐Ż travers eux et probablement ´┐Ż leur insu. Il semble bien que nous projetions sur les ´┐Ż´┐Żm´┐Żdia´┐Ż´┐Ż les d´┐Żrives de notre propre culture. Ce ne sont pas les vecteurs d'information qui sont d´┐Żvoy´┐Żs, ce sont les informations propag´┐Żes qui montrent une r´┐Żalit´┐Ż ne correspondant plus ´┐Ż ce que nous attendions. L'homme occidental ne veut pas de ces informations qui lui renvoient une image si ingrate de sa culture. Pour une foule d'individus, il serait pr´┐Żf´┐Żrable que l'information entretienne la langueur silencieuse des ab´┐Żmes de l'inconscient pour ne laisser transpara´┐Żtre que la beaut´┐Ż et la v´┐Żrit´┐Ż. C´┐Żest d´┐Żailleurs le r´┐Żle de certaines ´┐Żmission des t´┐Żl´┐Żvision ´┐Ż la sauce sucr´┐Że que d´┐Żeffacer les douleurs de la conscience. Ce ne sont pas les m´┐Żdia qui sont corrompus[7], mais bien plut´┐Żt les v´┐Żrit´┐Żs qu'ils d´┐Żvoilent qui pr´┐Żsentent un th´┐Ż´┐Żtre aux h´┐Żros pitoyables, nous, notre culture, les agents de nos soci´┐Żt´┐Żs. Pour une fois, dans notre culture, appara´┐Żt un d´┐Żcalage entre le ph´┐Żnom´┐Żne vie et sa repr´┐Żsentation imaginaire. Reprenons la phase de M. Henry en y glissant un autre sujet´┐Ż: ´┐Ż´┐ŻL´┐ŻHomme Blanc du Nord corrompt tout ce qu'il touche en pla´┐Żant dans l'inconsistant... l'´┐Żtre de l'Essentiel, ´┐Ż savoir l'accroissement en soi de la vie selon sa temporalit´┐Ż propre´┐Ż´┐Ż[8]. Et le sens devient r´┐Żaliste. ´┐Ż Mais cette r´┐Żv´┐Żlation n'est-elle pas positive ? Est-il permis de penser que nous ne confondrons plus le Noir d'Afrique avec celui de nos r´┐Żves angoiss´┐Żs; la sorci´┐Żre avec nos compagnes, le maghr´┐Żbin avec le Maure...´┐Ż? Nous sommes bien en pleine confusion quand nous parlons de barbarie, mettant notre monde au milieu de toutes les terres habit´┐Żes. Une cultures qui se met au centre de la modernit´┐Ż en exclut toutes les autres. Mais si elle accepte le dialogue/rencontre, un d´┐Żbat d'´┐Ż´┐Żauto-accroissement de la vie´┐Ż´┐Ż (au sens o´┐Ż l'entend Michel Henry) peut s'engager... ´┐Ż condition, bien s´┐Żr, d'accepter le risque de l'inconnu. Car ce qui est au plan des na´┐Żtions l'est aussi ´┐Ż celui des savoirs. Depuis des si´┐Żcles, le morcellement de la science profite ´┐Ż une certaine cosmogonie dont la conscience est le centre. Nous avons pill´┐Ż la plan´┐Żte au profit de l'Homme Blanc du Nord et nous avons exploit´┐Ż, razzi´┐Ż les patrimoines culturels des autres savoirs, des consciences autres dont le seul tort ´┐Żtait d'´┐Żtre diff´┐Żrentes. Et quand ce mouvement d'auto-accroissement de la vie ´┐Ż l'´┐Żchelle plan´┐Żtaire ne se nourrit plus des seules qualit´┐Żs de la conscience blanche, celle-ci s'´┐Żtiole, perd ses pouvoirs et meurt. Nous pouvons dire que la Nature n'aime plus l'Homme Blanc du Nord. Il y a des peuples qui agonisent apr´┐Żs que leur totem se soit bris´┐Ż. Notre civilisation doit savoir mourir car ses totems sont morts. Nietzsche ne l'avait-il pas dit ? Il n´┐Ż´┐Żtait que po´┐Żte´┐Ż Si les media me paraissent devoir ´┐Żtre affranchis des suspicions qui p´┐Żsent sur eux, on sait que, derri´┐Żre l´┐Żoutil, il y a des Hommes, les journalistes. Et ceux-ci, on peut l´┐Żavancer, ne connaissent pas leur outil. Il n´┐Żest pas s´┐Żr qu´┐Żils nous apprennent ´┐Ż bien mourir, au sens de civilisation, bien entendu. [1] ´┐Ż Les d´┐Żcisions de G. W. Bush junior sont, de ce point de vue, exemplaires. Qu´┐Żimporte que la plan´┐Żte cr´┐Żve pourvu que la machine de production am´┐Żricaine continue de fonctionner. [2] ´┐Ż Le dernier proph´┐Żte que l´┐ŻIslam attend, celui de la fin des temps. [3]´┐Ż In´┐Ż Lierre & Coudrier n´┐Ż8, 1987, p.8. [3] ´┐Ż Dans la bibliographie je donne des rep´┐Żres possibles. [4] ´┐Ż Robert Lenoble, Histoire de l'id´┐Że de Nature, Ed. Albin Michel, 1969 ; p.364. [5] ´┐Ż Michel Henry, La Barbarie,1987, ´┐Żd. Grasset, Paris. [6] ´┐Ż Ibid, p.197. [7] ´┐Ż Notons en passant que l´┐Żimage ´┐Żvoqu´┐Ż par Michel Henry renvoie tr´┐Żs pr´┐Żcis´┐Żment aux repr´┐Żsentations tr´┐Żs anciennes des d´┐Żmons. La corruption d´┐Żabord, l´┐Żinconsistance ensuite puis la n´┐Żgation de la vie´┐Ż [8] ´┐Ż Ibid, p.197.
Illel Kieser, le 12/06/2001
| ||
Envoyez vos commentaires et vos questions au r´┐Żgisseur du site. Copyright ´┐Ż ´┐Ż 1997 Lierre & Coudrier ´┐Żditeur |