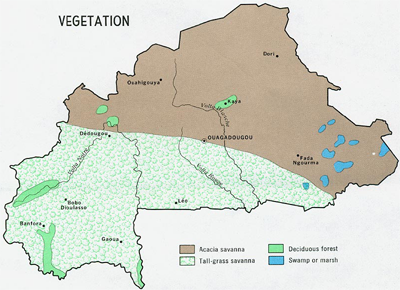Les ambitions d’une caisse populaire dans un village du Burkina Faso
L’exemple du groupement f�minin d’Aor�ma
3 000 FCFA
Grille de versement dans la caisse du groupement
Mat�riel
Versement 1ann�e Versement 2 ann�e Versement 3 ann�e etc, Tot
Brouette 6500 6500 6500
Arrosoirs 9000 9000
Pioche 2000 2000
Pelle 1125 1125
Rateau 1125 1125
Moule 1500 1500
Total 21250 21250 6500 etc,
A verser
Par an
Article V�: Ce mat�riel doit �tre bien entretenu, non utilis� � d’autres fins et, ne pourra �tre la propri�t� effective des p�pini�ristes qu’apr�s paiement des sommes dues.
Article VI�: Apr�s constat effectif de non paiement conform�ment aux d�lais impartis ou, de mauvaise utilisation et d’entretien, le mat�riel peut �tre imm�diatement retir� et r�troc�d� au groupement.
Article VII�: Pendant que le mat�riel est propri�t� du groupement, il est formellement interdit aux membres du groupement de vouloir utiliser le mat�riel sous n’importe quel pr�texte. Dans ce cas, le p�pini�riste pourra se plaindre devant qui de droit.
Article VIII�: Tout p�pini�riste qui apposera sa signature sur ce pr�sent contrat, est contraint de respecter toutes les clauses y aff�rentes..
Ouahigouya’_�_____________________________________________
Le p�pini�riste Le pr�sident du groupement
Ou�draogo Kassoum Ma�ga Habibou
Le coordonnateur du PAE/Y
Ou�draogo Boureima
Cette structure fonctionna tr�s bien, malgr� les contraintes des remboursements impos�es aux clients du projet ��Agro-Ecologie�� et la pr�carit� de leurs situations financi�res, tant que la gestion �tait confi�e � des expatri�s allemands. Mais, au terme de leur mission, toute cette �uvre a �t� transf�r�e entre les mains de gestionnaires locaux. Malheureusement, la direction de la structure fut confi�e � un fonctionnaire nomm� par le Minist�re de l’Agriculture. Ne connaissant rien aux probl�mes sp�cifiques de l’��agro-�cologie��, il conduisit celle-ci � sa ruine. La belle exp�rience cens�e apporter une modernisation de l’�quipement m�canique ainsi qu’un soulagement aux souffrances quotidiennes des agriculteurs, prit fin.
En ce sens, malgr� l’�chec de l’O.N.G allemande, il semble que son syst�me de fonctionnement a inspir�, entre autres, les groupements f�minins d’Aor�ma.
3 - Le mode de fonctionnement de la coop�rative
Les principes et la philosophie du R�seau des Caisses populaires du Burkina Faso, d’apr�s Monsieur Kassoum Ou�draogo et Madame Salma Boussa qui sont les deux figures de l’encadrement, sont les suivants�: ��l’argent du pays appartient � tout le monde. Faisons-en tous un bon usage pour que chacun puisse en tirer un certain profit suivant ses besoins, ses moyens��. Cette remarque s’explique par l’organisation des groupements. En effet, chaque groupe de femmes comprend trois repr�sentantes �lues en raison de certaines qualit�s comme le dynamisme, le charisme, la capacit� � conduire un groupe et � d�fendre ses int�r�ts, l’honn�tet� morale. Celle qui fait office de leader est charg�e de la signature des pr�ts du r�seau des Caisses Populaires � Youba, village qui fait office de centre commercial et administratif. Mais la r�ception de l’argent se fait en pr�sence de trois femmes � la fois pour �viter l’usage des fonds � titre personnel et toute tentative de d�tournement. Dans cette repr�sentativit�, chacune � un r�le pr�cis�: l’une est �lue pr�sidente du groupe, l’autre tr�sori�re (ou secr�taire, suivant le cas) et la troisi�me, tr�sori�re adjointe. Toutes les femmes des groupements ont un carnet du r�seau des Caisses Populaires qu’elles acqui�rent � un prix tr�s modique. Leur photo y figure afin d’�viter les mauvais usages, ainsi que leur signature. Les femmes illettr�es s’acquittent de cet acte obligatoire par l’empreinte de leur index. Si le d�p�t d’argent peut se faire par n’importe qui, en revanche, le retrait s’effectue en groupe. Par prudence, la garde de l’argent se fait chez les femmes elles-m�mes. Cette pr�caution �vite les tentations de vol�; d’autant plus que le pr�sident de ces groupements, M.�Kassoum Ou�draogo, auquel on confiait auparavant la garde de cet argent, a �t� victime de vol chez lui. L’association d’Aor�ma est une organisation de huit groupements diff�rents dont le nombre varie de quinze � cent cinquante personnes. Chaque groupe se donne un surnom de devise�:
-
Nabonswond� 1 = ��Nous prions Dieu�� (23 membres)
-
Nabonswond� 2 = ��Nous prions Dieu�� (9 membres)
-
Neeb Noona 1 = ��les gens sont bons�� (26 membres)
-
Neeb Noona 2 = ��les gens sont bons�� (16 membres)
-
Nonq Neer� = ��Nous aimons les bonnes choses�� (14 membres)
-
Baas Neer� = ��Nous aspirons � une heureuse fin�� (14 membres)
-
Naba Asuogo = ��nous serons heureux d’une bonne fin�� (16 membres)
-
Relwende = ��Nous suivons Dieu�� (8 membres)
Les groupes se constituent par quartier. Comme il y a huit quartiers � Aor�ma, on comprend qu’il y ait huit groupements diff�rents.
La modalit� et la dur�e du pr�t sont variables suivant les besoins et les projets des clients de l’association. En outre, quel que soit le montant du pr�t, il y a quatre mois d’essai qui sont impos�s et dont les conditions de remboursement doivent �tre strictement respect�es. Si au terme de ces mois, l’essai est probant, c’est-�-dire, s’il n’y a aucune perte d’argent, le R�seau des Caisses Populaires peut renouveler le contrat pour six mois suivant les m�mes conditions.
Par exemple, pour un pr�te de 50.000CFA (1CFA = 50 cts FFr), on exige 300Fr CFA de b�n�fice au minimum pour une semaine et au maximum entre 500 et 1000 Fr CFA, voir plus selon la nature de l’activit� commerciale. Le versement du b�n�fice � la caisse de la coop�rative pour le compte du R�seau des Caisses Populaires s’effectue tous les vendredis matin chez le Pr�sident des groupements et en pr�sence de l’employ�e de la caisse charg�e de l’encadrement de ces groupements f�minins. Il est fait obligation aux membres de l’association de r�aliser des b�n�fices qui varient suivant la nature de l’activit� exerc�e. Voici un exemple de contrat �tabli entre le R�seau des Caisses Populaires et une cliente.
R�SEAU DES CAISSES POPULAIRES DU BURKINA01 ILP. 5382 OUAGADOUGOU O1 PROGRAMME -CR�DIT, �PARGNE AVEC �DUCATION ACCORD DE PR�T SECTION 1�: Dans le village deAor�ma le 17-1-003 zone de Aor�ma province de Yatenga un accord de pr�t est conclu entre la caisse villageoise de Aor�ma Nongm�ero et la caisse populaire de Aor�ma Ce pr�t d’un montant de 375000 est remboursable en 17 semaines au taux constant de soit un int�r�t de 10% soit un int�r�t de 375000 Francs CFA. La date d’�ch�ance �tant fix�e le�: 17-05-003 SECTION 2�: La caisse villageoise consent r�partir le montant du pr�t entre ses membres en fonction des besoins exprim�s conform�ment � son r�glement int�rieur et aux r�glements du programme/CEE. SECTION 3�: La caisse villageoise, � travers ses membres, accepte l’encadrement de l’animatrice et s’engage � respecter l’enseignement et les r�glements du programme/CEE. SECTION 4�: La caisse populaire consent octroyer, aux conditions en vigueur, un nouveau pr�t d’un montant sup�rieur selon les besoins de chaque membre � la caisse villageoise si le remboursement int�gral en capital et int�r�t du pr�t qui fait l’objet de la pr�sente entente est correctement fait et dans les d�lais. SECTION 5�: En foi de quoi, les parties suivantes ont sign� ou appos� leur empreints digitale de l’index gauche�: a) Pour la caisse villageoise, le comit� de gestion Pr�sidente �: Nom Ou�draogo Liz�ta Signature�: Secr�taire/comptable �: Nom Ou�draogo Azeta Signature�: Tr�sori�re�: Nom Ou�draogo Raki�ta Signature�: b) Pour la caisse populaire�: Sankariba A�ssa Signature�: (Nom Repr�sentant) c) Pour le programme/CEE signature�: Boulsa Salmata (Repr�sentant) |
Les activit�s commerciales � Aor�ma sont les suivantes�:
-
vente de p�trole au d�tail ( pour alimenter les lampes � p�trole et pour allumer les foyers domestiques)�;
-
Commerce d’articles en gros avec une domination masculine incontestable�;
-
Vente au d�tail de sucre, huile, mil, riz, arachide etc.�;
-
Cr�ation de boutiques�;
-
Vente de savon traditionnel fabriqu� par les commer�antes elles-m�mes�;
-
Commerce de noix de kola en provenance des pays c�tiers comme la C�te d’Ivoire, le Ghana etc.�;
-
Vente de galettes, de boules d’ ��acassa���;.
-
Vendeuses itin�rantes sur les march�s locaux en utilisant soit les transports en commun (taxi-brousse) pour l’achat ou la vente de sacs de mil, d’arachides, d’haricots, de petits pois etc. , soit � pied, � v�lo ou � mobylette quand les articles sont moins encombrants.
J’ai pos� la question aux deux personnes charg�es de l’encadrement afin de savoir pourquoi un groupement de femmes. J’ai eu la r�ponse suivante�: ��Les femmes font preuve de tranquillit� � l’inverse des hommes qui manquent de s�rieux. L’�chec du centre nutritionnel d’Aor�ma et surtout le centre d’��agro-Ecologie�� initi� par une O.N.G allemande, sous l’�gide de la C.E.E, dirig�s essentiellement par des hommes, est une preuve manifeste du manque de s�rieux des hommes. En effet, les hommes ont tendance � faire un usage personnel de l’argent qu’ils ont emprunt�. Cette conduite, certes, a ses raisons�: ils sont soumis � des exigences quotidiennes, � des sollicitations de tous genres comme les devoirs familiaux qui d�passent infiniment leur pouvoir d’achat. D�s lors, ils sont tent�s d’utiliser l’argent pr�t� � d’autres fins que celles pour lesquelles il avait �t� demand�. Toutefois, chaque homme peut toujours, de son propre chef, aller faire un emprunt � la banque ou � la Caisse Populaire sans devoir passer par la structure de l’organisation des femmes.
Mais l’une des raisons majeures qui expliquent l’absence de groupements masculins tient � leur temp�rament fort. Les hommes sont g�n�ralement orgueilleux et sujets aux disputes. Ils font montre de difficult�s � s’entendre, � s’accorder sur une modalit� de fonctionnement. Chacun aspire � se mettre en avant en �crasant l’autre, � commander, diriger, conduire les faits suivant son int�r�t personnel et non celui du public ou de l’int�r�t g�n�ral, celui du village, par exemple��. Pour l’association des femmes d’Aor�ma, il y a tout de m�me un encadrement.
4 - L’encadrement
Les leaders du village figurent, de fait, parmi les repr�sentants de l’association d’apr�s Madame Boulsa Salmata. Parmi eux il y a Kassoum Ou�draogo, d�sign� comme membre permanent et Pr�sident des groupements f�minins de son village�; d’o� le fait que tout se passe dans sa propre cour�: partage des pr�ts et des b�n�fices etc. Il est second� par deux autres co-repr�sentants qui changent assez souvent parce qu’ils sont moins int�ress�s par l’activit� b�n�vole. S’il n’y a pas d’argent � gagner, de rentabilit� ou de b�n�fice sous quelque nature que ce soit, il n’y a pas non plus d’int�r�t pour le b�n�volat, reconna�t la m�me interlocutrice. Ils ont le sentiment de perdre leur temps.
Dans le cahier de chaque groupe, le Pr�sident note l’assiduit� et la ponctualit� de chaque membre par la mention ��bon��, ��mal��, ��X�� ou ��0��. En effet, selon le Pr�sident, certaines femmes, apr�s avoir re�u l’argent, manifestent moins d’enthousiasme � venir participer aux r�unions hebdomadaires ou � celles de la quinzaine. Suivant le nombre de ��X�� ou de ��0��, on peut sanctionner la n�gligente en diminuant de moiti�, � l’avenir, le montant de la somme qu’elle aimerait emprunter au r�seau des Caisses Populaires par l’interm�diaire des groupements f�minins. Les frais de tenue de compte s’�l�vent � 1200 CFA par mois.
Madame Salmata Boulsa, employ�e du R�seau des Caisses Populaires � Ouahigouya, repr�sente celui-ci comme animatrice de leur programme en milieu rural. A cette fin, elle se rend � Aor�ma toutes les semaines pour encaisser l’argent (b�n�fices r�alis�s), �tablir et v�rifier les comptes des diff�rents groupes. Elle remet la somme du jour collect�e aux trois femmes responsables de chaque groupe pour effectuer le versement sur le compte commun de l’association � la Caisse Populaire de Youba.
5 - Les difficult�s rencontr�es dans le fonctionnement de l’association
Madame Salmata Boulsa analyse de la mani�re suivante les �cueils rencontr�s sur le terrain. D’abord, la sensibilisation des femmes � l’int�r�t et � la n�cessit� de l’association est tr�s lente. M�me quand elle se fait, on s’aper�oit que certaines femmes comprennent mal le sens de l’information et font tout le contraire de ce qui est exig�, conseill�. Il arrive que d’autres oublient les dates de remboursement ou de l’�pargne. D�s lors, il est n�cessaire qu’il y ait une information continue � l’int�rieur de chaque groupe pour �viter nombre d’inconv�nients�; la finalit� �tant de les conduire toutes � plus d’entraide. On prend soin d’�viter que les femmes d’un groupe soient mises au courant de la d�faillance de l’un de ses membres afin d’�viter toute forme d’humiliation, d’ironie, de m�pris. On remarque aussi l’attitude de certains maris qui s’opposent � la participation de leurs �pouses aux r�unions d’information sur le programme du R�seau des Caisses Populaires, voire � leurs activit�s de crainte que leur commerce ne les conduise � acqu�rir plus de libert� dans un contexte social et culturel domin� par l’Islam. D�s lors, suivant leur int�r�t et leur accord, ces maris r�calcitrants peuvent autoriser leur femme � sortir et � rentrer dans un sous-groupe de 4 � 5 femmes environ. Parfois, il faut l’intervention des leaders du village, comme le chef ou une personnalit� influente comme Kassoum Ou�draogo, pour parvenir � att�nuer leur r�sistance. M�me l� encore, de nombreuses r�unions publiques avec de tels maris et leurs femmes sont n�cessaires pour pr�senter, expliquer le bien-fond� de l’initiative du R�seau des Caisses Populaires � Aor�ma et, finalement, les persuader.
Ensuite, il y a des m�sententes assez fr�quentes � l’int�rieur des sous-groupe (les femmes d’une m�me concession ou cour). C’est souvent le fait des co-�pouses qui se jalousent et sont promptes � se r�jouir du malheur et des faux pas des unes et des autres. Toutefois, elle reconna�t que globalement les activit�s des groupements marchent plut�t bien � Aor�ma, lesquels sont souvent cit�s en exemple dans le Yatenga.
6 - Finalit� des groupements f�minins d’Aor�ma
Monsieur Kassoum Ou�draogo, tout autant que Madame Salmata Boulsa, affirment que les int�r�ts de la Caisse Populaire g�n�r�s par l’activit� des groupements des femmes � Aor�ma servent � financer certains travaux collectifs comme les d�penses de la commune. Ainsi, quel que soit le montant d’un pr�t, chacun doit verser 100 Fr CFA par mois sur la caisse commune�: somme qui sert � d�panner ou � entretenir les pompes d’eau villageoises, le moulin � grain, la construction de maternit�. En ce sens, l’activit� des femmes contribue au d�veloppement du village. Elles ach�tent aussi des c�r�ales (mil, sorgho etc.) pendant les r�coltes, p�riode o� leur prix est tr�s faible, pour les revendre avec une plus-value importante pendant la saison des pluies. D’un point de vue psychologique, elles �prouvent de la fiert� � pouvoir gagner de l’argent personnel par la r�alisation d’un certain b�n�fice dans leur activit� propre.
En outre, pendant la saison des travaux champ�tres (saison des pluies), le travail des champs isole beaucoup les femmes. Les r�unions bi-hebdomadaires du R�seau des Caisses Populaires leur permettent de maintenir, voire de cr�er des liens, contacts, amiti�s, �changes de nouvelles, d’informations. Elles v�hiculent l’information aux absentes par n�cessit� (enfant malade). C’est �galement pour elles l’occasion de s’instruire mutuellement de leurs �checs ou de leur succ�s dans leurs entreprises sp�cifiques.
Les activit�s des femmes permettent un relatif confort dans les familles. En effet, si l’homme a en charge de remplir ses greniers de mil et d’en distribuer de fa�on �quitable en cas de besoin, la femme doit s’arranger pour trouver les condiments de la sauce. Elles prennent en charge �galement la sant� de leurs enfants (achat de m�dicaments). Gr�ce aux fruits de leur activit� mercantile, elles soulagent donc les familles au niveau de leurs d�penses quotidiennes, d’autant plus qu’une bonne partie des habitants du Burkina Faso vit dans une extr�me pauvret�.
En d�finitive, on peut affirmer que les membres des groupements f�minins d’Aor�ma participent activement � la vie �conomique et au d�veloppement du village. Mieux, elles aspirent ainsi � une certaine autonomie et ind�pendance par rapport � leur mari dans cette r�gion domin�e par l’Islam o� la mentalit� voudrait domestiquer la femme. Elles visent ainsi � un enrichissement personnel. Enfin, si cette structure conna�t un certain succ�s, malgr� les difficult�s r�elles, c’est parce qu’elle se fonde sur le dynamisme, le savoir-faire, l’intelligence, le sens du bien public, de l’int�r�t g�n�ral de la femme. En ce sens, la femme, chez les peuples africains, appara�t comme l’avenir des pays africains par sa comp�tence et sa qualit� de la gestion des affaires publiques.
1 - 1 Euro =556 F.CFA

f�vrier 2006 par Pierre Bamony
Notes�:
Web favorites
Rubriques
Derniers articles
Articles les plus populaires
Derniers commentaires
-
Conversation imaginaire avec Etty Hillesum
Par Webma�tre, 3 d�cembre -
Conversation imaginaire avec Etty Hillesum
Par Ricardo Martinez, 2 d�cembre -
Non � la prescription des crimes sexuels commis sur les enfants
Par Webma�tre, 26 novembre -
Non � la prescription des crimes sexuels commis sur les enfants
Par TORRES Sophie, 23 novembre -
Dubuffet et l’art brut
Par Yvette Reynaud-Kherlakian, 9 novembre