Aby Moritz Warburg
Une anthropologie de l’image
Avec Warburg, l’histoire de l’art n’op�re plus aux confins de l’anthropologie : elle en est une cat�gorie. Plut�t que leur beaut�, il met en �vidence l’efficacit� des images. Ses mots cl�s sont : survivance, magie, empathie, animisme, tot�misme...
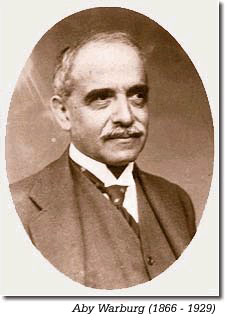 |
| Aby Moritz Warburg – 1866-1929 |
Aby Moritz Warburg (1866 - 1929) est pr�sent� comme un historien de l’art. Son travail a servi � jeter les bases de l’iconographie mais on pourrait dire qu’il est l’anc�tre d’une anthropologie des images. Son exp�rience d’historien et son v�cu donnent � son projet une dimension humaine fort profonde. Celle-ci, malheureusement n’a eu que peu d’�chos. On peut cependant citer Georges Didi-Hubermann qui poursuit sa recherche sur la base des travaux de Aby Warburg. [1]
Il assigne � l’iconographie, le dessein d’« op�rer une d�composition [de l’�uvre] qui en fera appara�tre clairement l’h�t�rog�n�it� mat�rielle ou essentielle ». Ses travaux le conduiront � reprendre cette m�me id�e que Nietzsche avait d�velopp�e dans La Naissance de la trag�die, qui voit appara�tre chez les Grecs une civilisation prise entre la raison repr�sent� par Apollon et la passion par Dionysos. Id�e que Michel Maffesoli a reprise abondamment. On pourrait prolonger la dialectique en y incluant les termes que nous avons utilis�s tout au long de cette �tude : Imaginaire/conscience, pens�e/sentiment, etc.
En 1895-1896, au cours d’un voyage aux �tats-unis, Aby Warburg se rend dans le Sud-Ouest dans les pueblos, o� r�sident les indiens Hopis. Il d�couvre leur art et diff�rentes traditions spirituelles dont la « danse du serpent », les poup�es kashinas et il assiste � des danses rituelles.
| Poup�e Kashina, fabriqu�es par des artistes contemporains |
|

|

|
|
Kashina Navajos – Christine Clifford |
Kashina Hopi – Edwin Quotskuyva |
En 1918, il est hospitalis� apr�s un �pisode psychotique aigu. Il n’en poursuit pas moins ses travaux, contre l’avis du Dr. Binswanger, son m�decin. Il n�gocie sa sortie en proposant de monter un projet scientifique autour et � partir de son exp�rience chez les Indiens Hopis.
En 1923, donc, il pr�sente les principaux �l�ments de sa recherche et les grands axes de sa th�orie. Il y d�fend le haut degr� de la civilisation hopi dont les rites, selon lui, proc�dent d’une n�cessit� pratique – faire venir la pluie, mettre fin � la st�rilit� d’un couple, etc. En �voquant la « danse du serpent », dont il a �t� t�moin, il insiste sur le niveau symbolique du rituel : le serpent n’est pas r�ellement sacrifi�, mais « int�gr� » quand l’officiant le prend dans sa bouche puis le rel�che dans la nature pour aller « porter le message ». Nous dirions donc que son interpr�tation insiste sur le caract�re de repr�sentation du rituel mais il occulte l’aspect « transitionnel » et m�diateur du serpent. Il ne prend pas en consid�ration le caract�re d’imitation du sacrifice du serpent qui est une imitatio dei, au cours de laquelle le monde du peuple Hopi est recr��. Marie Louis Von Franz insiste sur ce point dans Les mythes de cr�ation. [2] Chaque danse recr�e le monde et le renouvelle, ce qui est aussi une mani�re de laisser toujours ouverte la porte de communication entre l’imaginaire et la conscience, afin que jamais celle-ci ne se fige dans une attitude ou une autre. [3] Cette souplesse de la conscience, c’est justement ce que l’Homme Blanc a perdu. Pour le peuple des Hopis, cette adaptabilit� �tait rendue n�cessaire par les conditions g�oclimatiques. Une conscience rigide, incapable d’adopter de nouveaux comportements eut �t� fatale � la survie.
Aby Warburg a rapport� des photos des poup�es kashina. Les kashina repr�sentent les esprits des plantes, des animaux, des forces de la nature et des anc�tres. Ce sont des entit�s psychiques dont le pouvoir est sp�cifique. Ces esprits vivent de juillet � d�cembre au sommet des montagnes et reviennent vivre aupr�s des Hopi du solstice d’hiver � celui d’�t�. On s’adresse � eux pour appeler la pluie ou faire fuir un malheur. Il en existe plus de 250, qui sont figur�s par des poup�es que l’on donne aux enfants pour leur apprendre ce que chaque esprit-kashina repr�sente : kashina-papillon, kashina-grosse t�te, kashina-clown, etc. Les hommes eux-m�mes peuvent figurer les kashina en se rev�tant des attributs de l’un ou l’autre de ces esprits durant des c�r�monies rituelles.
(Plus au sud, chez les Quechuas, notamment, la poup�e repr�sentative d’un esprit est pr�sente �galement lors de certaines c�r�monies. On la retrouve dans les rituels shinto�stes)
� travers ces poup�es, le g�nie Hopi r�alise une op�ration complexe de repr�sentation et de transmission. La poup�e, par le jeu de l’enfant, est un op�rateur de transmission d’une cosmogonie. Par elle, l’enfant apprend comment le peuple auquel il appartient �tablit une alliance entre les Hommes et la nature, le monde environnant. Avec l’adulte, la poup�e devient un op�rateur mn�motechnique de communication avec cette partie de l’imaginaire qui pose probl�me � un moment. (Je pense que Aby Warburg s’est inspir� des poup�es kashina pour cr�er son tableau « mn�mosyne ») Elle est un agent physique de l’imaginal et sa parure induit la mani�re dont il faudra la « mettre en sc�ne » : si l’on tient une kashina-clown pour r�gler, par exemple, un conflit difficile entre deux tribus, le rituel sera fond� sur une mise en sc�ne ludique qui tournera en d�rision le s�rieux de chacune des parties... [4]
Un projet avort�
Comprendre le projet de A. Warburg induit, en premier lieu, un retour sur l’histoire de l’art en tant que discipline et donc une nouvelle d�finition des termes, et en particulier de la « temporalit� ». Loin d’�tre continu, le temps historique – diachronique, lin�aire – ne s’exprime pour Aby Warburg que par strates, red�couvertes, retours et survivances. L’histoire de l’art est d’abord histoire de la culture, mais aussi de sa transmission et de sa survie. Prolongeant sa r�flexion sur cette question de la survivance. Warburg fait plus qu’explorer � nouveau l’histoire de l’art, avec de nouveaux mod�les m�thodologiques, il p�n�tre dans le monde de la psych� en posant des questions essentielles et en rendant � l’image une dimension de vie.V�ritable anthropologue des images, l’entreprise de Aby Warburg rel�ve d’une anthropologie de la culture occidentale dans laquelle une pluralit� de disciplines est convoqu�e, comme la philologie, l’ethnologie mais aussi la biologie et l’histoire. Cette anthropologie aurait alors pour dessein de r�pondre � une question qui lui para�t fondamentale : que reste-t-il d’une image ? Quelles sont ses survivances, ses traces ? Il ne s’agit donc plus simplement de savoir ce que signifie une image, puisqu’il faut avant tout se pencher sur sa vie et sa transmission. Warburg nous fait p�n�trer dans un univers de repr�sentations et non de faits concrets. Il nous exhorte � percevoir d’abord la charge de la repr�sentation. Historien de l’art, il nous demande par exemple ce que repr�sente pour nous l’art de la Renaissance, puis il interroge l’art de la Renaissance pour savoir ce que l’art romain pouvait repr�senter durant cette p�riode. � travers son projet, Warburg ne dit rien moins que l’image n’est pas un objet mort mais qu’elle demeure vivante et, comme le serpent ou les kashina, son pouvoir continue d’op�rer, l� ou celui-ci s’est instaur�, l� o� la nature lui assign� une fonction.
Aby Warburg s’interroge sur la survivance de l’image � travers les cultures, il ne r�pondra jamais � la question d�finitivement. Il invente un syst�me mn�motechnique directement inspir� du rationalisme. Des panneaux sur lesquels s’inscrivent des images et dont le d�placement change le sens du tableau global. R�invention du pictogramme, m�lange de dazibao et de tablette indienne, certes, �chec d’une v�ritable m�thode de conservation de l’image car elle s’inscrit dans la culture de cette �poque et il lui fallait convaincre ses th�rapeutes – Ludwig Binswanger – qu’il �tait en mesure de conduire un projet scientifique.
Si Aby Warburg n’a pas trouv� la r�ponse � une question primordiale pour lui, c’est probablement parce qu’il en cherchait les r�ponses � l’ext�rieur, pas � l’int�rieur. Dialectique int�rieur/ext�rieur que la conscience blanche n’a pas encore r�solue. Puissamment press� par son �quipe soignante il n’a probablement pas eu le temps de s’emparer de la th�orie des arch�types et il est demeur� tributaire de l’impact culturel environnant. Les images sont � l’int�rieur, universelles et �ternelles. Neutres d’abord, c’est l’existence d’une conscience qui leur donne vie. Marie Louise Von Franz, � sa mani�re, a poursuivi aussi l’�uvre de Warburg en r�pondant � la question de la trace.
Aby Warburg a eu l’immense m�rite de d�border l’�troit espace de l’iconographie pour lui donner une profondeur psychique qui reste encore largement � explorer.
novembre 2006 par Illel Kieser
Notes :
[1] – Lire notamment L’image survivante. Histoire de l’art et le temps des fant�mes selon Aby Warburg, �d. De Minuit, coll. Paradoxe, Paris, 2002.
[2] – Chez La Fontaine de Pierre, �diteur, Paris.
[3] – Finalement, le r�sultat convaincra l’�quipe soignante qui l’autorisera � reprendre ses travaux.
[4] – J’ai ainsi assist� � de nombreuses c�r�monies sp�cifiques : conflit de couple, histoire sentimentales, �changes entre familles, etc. On aura de plus amples d�tails sur un site indien Artisanat indien o� se trouve une abondante documentation sur les c�r�monies et les medecine men. http://www.artisanatindien.com
Best of the web
- Casino En Ligne
- Casino En Ligne
- Paris Sportif Crypto
- Meilleur Site Casino Live
- Meilleur Casino En Ligne
- Casino En Ligne France Légal
- Casino En Ligne
- Meilleur Casino En Ligne
- Meilleur Casino En Ligne 2025
- Meilleur Casino En Ligne 2025
- Meilleur Casino En Ligne
- Nouveau Jeu Casino En Ligne
- Meilleur Casino En Ligne Français
- Meilleur Casino En Ligne
- Casino En Ligne Fiable
- Meilleur Casino En Ligne
- Casino En Ligne France
- Meilleur Casino En Ligne Avis
- Nouveau Casino En Ligne Francais
- Casino En Ligne France
- Jeu Sweet Bonanza Avis
- Parier Sur Ufc
- Casino En Ligne
- Meilleur Casino En Ligne Français
- Meilleur Casino En Ligne 2026
- Casino En Ligne France Légal
- Nouveau Casino En Ligne Francais
- Bonus Sans Dépôt Nouveau Casino
- Meilleur Casino En Ligne
- Casino En Ligne
- Meilleur Casino En Ligne
- Casino En Ligne Français 2026
- Casino Online France
Rubriques
Derniers articles
Articles les plus populaires
Derniers commentaires
-
Dubuffet et l’art brut
Par Yvette Reynaud-Kherlakian, 3 novembre -
La marque de l’inceste
Par Gloria, 17 octobre -
Conversation imaginaire avec Etty Hillesum
Par Webma�tre, 27 septembre -
Le voile et le string
, 21 septembre -
Conversation imaginaire avec Etty Hillesum
Par caroline gindre, 20 septembre
